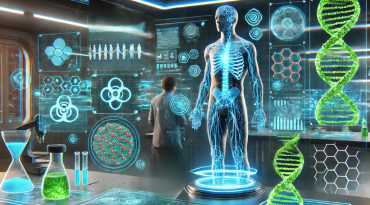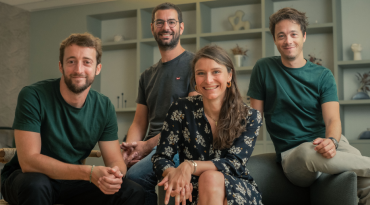Michaël V. Dandrieux, Ph.D, est sociologue de l’imaginaire, cofondateur et président du cabinet de conseil en stratégie Eranos. Il enseigne à Sciences Po Paris (Ecole de Management et d’Innovation). Il travaille sur la réconciliation de l’entreprise et de la société dans laquelle elle prospère. Chez Eranos, il a notamment accompagné La Poste BSCC sur la dématérialisation et l’écologie de l’attention, Perrier Jouët sur le rapport à la Nature, Pierre Fabre sur le soin du futur, ou encore L’Oréal USA sur la confiance en soi chez les femmes. Au centre de son analyse, l’évolution du rôle traditionnellement accepté pour une entreprise.
Alliancy. En juin dernier, vous interveniez à l’USI (Unexpected Sources of Inspiration) sur le thème « L’entreprise en soi est-elle une maladie pour la planète ? » Quelle analyse, quelles observations vous ont mené à cette question provocatrice ?
Michaël V. Dandrieux. Préservation de l’environnement, respect des diversités, évolution du travail… : l’entreprise doit sans cesse s’adapter à de nouvelles pressions qui émanent de la société civile.
Cette transformation profonde, entamée il y a une soixantaine d’années, est désormais lisible jusque dans le champ réglementaire, avec la loi Pacte en France par exemple. On la perçoit également dans les discours des étudiants qui sortent des grandes écoles et nous annoncent qu’ils vont « changer la donne ». Dans des figures patronales comme Emmanuel Faber.
Les symptômes sont nets et les remèdes proposés se multiplient. Mais de quelle maladie parlons-nous ? La maladie, c’est la façon dont nous avons pensé l’entreprise au siècle dernier : un système dont la vocation serait exclusivement de redistribuer les gains aux actionnaires. Il est évident aujourd’hui que ce n’est pas possible, ne serait-ce que parce que nous épuisons les ressources dont nous tirons des bénéfices. D’un simple point de vue économique – et je ne parle même pas d’écologie – on se rend bien compte qu’on ne pourra pas produire éternellement de cette manière-là.
Je me suis souvent demandé d’où venait cette méprise. Cette erreur collective. En tant que sociologue de l’imaginaire, je travaille sur notre irrationalité. Nous ne sommes pas des êtres rationnels, sans quoi nous ne serions pas en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Le désir, la foi, la confiance… rien de tout cela n’est rationnel ! Et pourtant c’est ce qui nous anime.
Quelles devraient être aujourd’hui les priorités de l’entreprise ?
M.D. L’un de ses enjeux les plus importants est de protéger le milieu dans lequel elle opère, celui qui lui permet de prospérer.
Quand elle ne le fait pas, on assiste à des développements comme Uber, dont le principe même est d’arriver dans un milieu, de l’assécher complètement, d’exploiter les populations-cibles et quand il est débouté par le gouvernement local – ce qui prend toujours un peu de temps – de se déplacer ailleurs et de recommencer. Moins vous avez de racines, plus vous pouvez partir vite. Une entreprise qui n’est pas impliquée dans son territoire est plus agile. Mais est-ce ce que nous voulons ?
Quel cas de réconciliation de l’entreprise et de la société vous a le plus marqué ces dernières années ?
M.D. Le meilleur exemple est celui de La Poste. Une structure prise dans une tourmente très forte : la baisse du courrier. Pour eux, il y a quelques années encore, l’ennemi c’était la dématérialisation.
Nous avons travaillé avec la direction de la marque Courriers – Colis. Nous avons démontré que la dématérialisation était un récit social, un imaginaire. En 2020, la revue Nature a publié un article indiquant que la technomasse (la masse de matériaux issus des activités humaines) dépasserait sous 6 ans celle des organismes vivants sur notre planète. Nous ne dématérialisons rien du tout : nous produisons toujours plus de matière.
A côté de cela s’ouvre un champ : l’écologie de l’attention. Nous, les humains, avons créé la crise de l’attention, la sur-sollicitation permanente, toutes ces conversations parallèles et infinies, qui ne sont jamais closes, sur nos téléphones et nos ordinateurs. Notre capacité de nous concentrer décroît.
Nous avons donc attiré l’attention de la Poste sur le fait que le courrier est un objet sous-sollicitant – et dans un contexte de rareté de l’attention, c’est un vrai atout. Dire à un client d’arrêter d’envoyer des emails, ce n’est pas évident, parce qu’il est comme piégé dans un imaginaire : nous croyons que la digitalisation est le sens de l’histoire. Alors nous avons construit un outil de décision à l’usage de ceux qui envoient des notifications : ce message est-il pertinent ? Quel est l’effet recherché ? Dans certaines situations, la notification de l’app ou l’email sont tout simplement moins performants, et ils ajoutent à la crise de l’attention !
La Poste, dans sa mission d’utilité publique, peut être porteur de cette réconciliation. Il ne s’agit pas du tout d’être contre le digital, mais simplement d’accompagner ses clients à trouver le bon canal pour le bon message. Comme elle, je pense que toutes les entreprises ont un rôle à jouer dans la transformation de notre rapport à la matière, et dans notre crise collective de l’attention.
Elles doivent résoudre des problèmes de société de manière profitable, et s’efforcer de ne pas profiter de la création de nouveaux problèmes, comme le dit Colin Mayer.
Quel est le degré d’urgence de ces bouleversements en cours ?
M.D. Les entreprises font face à une situation très nouvelle : l’urgence du long terme. Il s’agit d’agir dès maintenant, pour avoir un impact dans très longtemps. La plupart de nos organisations n’arrivent pas encore à s’en saisir. C’est l’écartèlement entre « fin du monde et fin de mois », une formule apparue durant la crise des gilets jaunes et théorisée par Christian Gollier, économiste et membre du GIEC.
Qu’est-ce qui vous donne des raisons d’espérer ?
Notre problème actuel, c’est que nous agissons par « post-icipation » : nous agissons quand il est trop tard ! Mais quand j’étais étudiant, j’avais un professeur – Jacques Goldberg – éthologue et passionné par les termites. Il nous a invités à réfléchir aux termitières : à toutes ces galeries qui curieusement ne s’effondrent pas. Pourtant, par définition, plus la termitière prospère, plus le milieu dans lequel le termite opère est fragilisé !
Ce qui fait la force des termites, c’est d’avoir développé un comportement adaptatif : elles sont sensibles à une « vibration d’alerte ». Les mandibules, en plus de leur capacité d’excavation, permettent aux termites de sentir les vibrations dans le bois : une vibration en particulier les prévient que le bois dans lequel ils creusent est en danger. Chaque spécimen adapte alors son travail, individuellement et ralentit.
Cela me donne de l’espoir, parce que si les termites y arrivent, je suis certain que nous pouvons y arriver aussi. Nous voyons aujourd’hui de nombreux signes : Loi Pacte, certifications, standardisation de la comptabilité extra-financière, modèles de capitalismes à parties prenantes, mobilisation des jeunes parfois radicale, enseignements dans les grandes écoles (j’enseigne sur l’Habitabilité du monde à SciencesPo !)… Est-ce que ce ne serait pas notre vibration d’alerte ?

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique