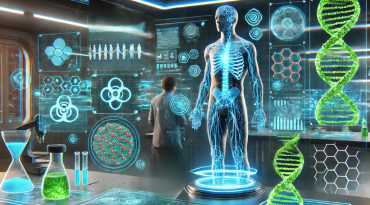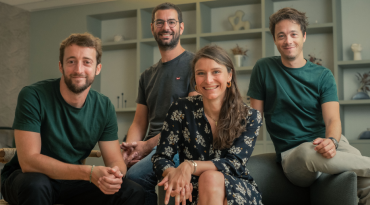Les DeepTech opèrent un transfert technologique du monde de la recherche vers le tissu socio-économique du pays. Comment gèrent-elles leurs recrutements et particulièrement les toutes premières embauches ? Quelles spécificités présentent-elles, par rapport aux start-up « classiques » ?
 Les DeepTech – ces start-up dont l’offre s’appuie sur une innovation dite « de rupture » – restent couvées par les pouvoirs publics. Dès 2019, la BPI leur avait consacré un plan de trois milliards d’euros (Génération Deeptech). Un intérêt que n’est pas venu démentir le plan « France 2030 » qui identifie ces entreprises comme porteuses de solutions d’avenir pour la France, au croisement de la recherche fondamentale et de l’innovation technologique.
Les DeepTech – ces start-up dont l’offre s’appuie sur une innovation dite « de rupture » – restent couvées par les pouvoirs publics. Dès 2019, la BPI leur avait consacré un plan de trois milliards d’euros (Génération Deeptech). Un intérêt que n’est pas venu démentir le plan « France 2030 » qui identifie ces entreprises comme porteuses de solutions d’avenir pour la France, au croisement de la recherche fondamentale et de l’innovation technologique.
Autre signal envoyé par le corps politique, le rapport Midy sur le financement des start-up se concrétise dans l’actuel projet de loi de Finances : le député Renaissance a déposé une série d’amendements destiné à favoriser l’investissement dans les jeunes pousses. Il donne naissance à deux nouvelles catégories de start-up : les « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) et les « jeunes entreprises d’innovation et de rupture » (JEIR), qui bénéficient de déductions de cotisations sociales à l’embauche.
Les Deeptech ont le vent en poupe, à tel point que le terme « Deeptech washing » commence à émerger. Le gouvernement avait annoncé en juin dernier son intention de créer un label dédié pour les entreprises qui prétendent à ce titre, mais aussi pour les fonds qui les financent. Objectif : s’entendre sur une définition commune, afin d’éviter que le soutien public à ce secteur ne soit finalement mal fléché.
Le CV des fondateurs : essentiel pour débuter
Sans surprise, les DeepTechs sont souvent créées par des experts de leur discipline : enseignant-chercheur, professeur de médecine, ou docteur en mathématiques. Les associés ont rarement des profils de serial entrepreneurs, ce sont plutôt des « stars » dans leur spécialité ce qui est … indispensable, car les levées de fonds se font avant tout sur leur CV.
En effet, une Deeptech, plus qu’une autre start-up, doit prévoir de longues années de développement pour aboutir à un produit commercialisable. Les technologies sont complexes, le marché pas forcément mature. C’est donc un pari sur l’avenir et un investissement à moyen ou long terme. La patience est de mise, tant du côté des financeurs que de celui des collaborateurs.
Le rapport au risque, à la gestion de l’échec, sont essentielles pour garder les équipes motivées. Voire pour les garder tout court.
D’autant que les Deeptech pourraient pâtir de l’essoufflement global des start-up en termes d’attractivité : « Charge de travail trop lourde, absence d’avantages sociaux, manque d’encadrement… Beaucoup de jeunes diplômés préfèrent rejoindre de grosses entreprises » plutôt que les « early start-up », soulignait Le Monde ce mois-ci.
Une équipe pluri-disciplinaire
Autre défi : réussir à marier des profils multi-disciplinaires, tous ces métiers étant « pointus » mais pas nécessairement habitués à travailler ensemble. En particulier lorsqu’il s’agit d’aligner des travaux de recherche, biologique par exemple, avec des enjeux de production à l’échelle industrielle ou des objectifs de vente.
Dans une récente émission Alliancy Connect, « Deeptech : ces jeunes pousses qui répondent aux grands défis de demain », Maud Vinet, CEO et co-fondatrice de SiQuance, une DeepTech créée en 2022 autour du quantique, expliquait comment son défi était de créer « une vision pluridisciplinaire », tout en « sortant de la recherche fondamentale pour avoir quelque chose à proposer au marché ».
Elle annonçait une prochaine levée de fonds (levée qui a eu lieu cet été) et son intention de doubler ses effectifs, passant de 10 collaborateurs à 20 d’ici la fin d’année. Pour réussir son pari, elle prend en charge « les métiers d’ingénierie et d’industrialisation » et elle s’appuie sur le CEA et le CNRS, dont son entreprise est issue, pour le volet recherche.
Autre levier, à ne pas négliger : l’écosystème local. Pour Maud Vinet, il s’agit de l’environnement grenoblois, très dynamique : centres de R&D, PME, etc. « Tout cela forme un continuum entre l’innovation et l’industrie. »
(Toujours) pas de DRH sur la ligne de départ
Comme ailleurs, rares sont les Deeptech qui créent immédiatement un poste de DRH. Cette fonction reste associée à une augmentation significative du nombre de collaborateurs. Le DRH vient répondre à un sujet de volume, on ne va pas le chercher pour apporter une vision ou une expertise.
Le DRH n’apparaît que lorsque le nombre de collaborateurs augmente trop pour que le CEO puisse continuer s’en charger. Mais ce que les Deeptech donnent surtout à voir en matière de RH, c’est une volonté de se distinguer dans la guerre des talents, en misant sur la mission de l’entreprise.
Questions de sens
Chez Niryo (2016, 34 collaborateurs), qui s’est donné pour ambition de « rendre les bras robotisés plus accessibles, les démocratiser et les déployer hors du contexte strict des usines », on se définit comme « entreprise à impact ».
Chez DNA Script – 12 offres en CDI actuellement – « leader mondial dans la fabrication d’acides nucléiques de synthèse en utilisant une technologie enzymatique de pointe », producteur de « Syntax, la première imprimante à ADN mettant en œuvre la technologie EDS, destinée aux laboratoires de recherche », on a levé levé plus de 315 millions de dollars et on cherche des « candidats qui veulent avoir un impact positif ».
Une difficulté cependant pour ces équipes de recrutement : elles ont certes la possibilité de valoriser le « sens » de leur entreprise, leur impact, mais elles font face aussi à des questionnements éthiques : qu’allons-nous livrer au monde, quels usages seront faits de notre produit « de laboratoire » ?
Des questions qu’il serait judicieux de confier à… un(e) DRH. Non ?
Témoignages
Killian Vermersch, co-fondateur de Golem.ai
« Trouver l’équilibre entre juniors et seniors »
« Je suis le CEO de Golem depuis un an, après en avoir été le CTO pendant les six premières années. J’ai un profil technique, aussi j’ai beaucoup recruté moi-même, en particulier sur les profils Tech. Golem est toujours une DeepTech, qui développe un socle technologique, mais aussi une entreprise SaaS, avec un produit sur étagère.
La moitié des équipes chez nous, voire les deux tiers, exercent des métiers Tech : des développeurs notamment. Nous avons aussi embauché des Business Analysts.
En sept ans, nous avons traversé plusieurs phases. Nous avons eu la chance de commencer avec déjà une activité d’agence, qui rapportait de l’argent : donc nous n’avions pas besoin de lever des fonds immédiatement. Par ailleurs, mon co-fondateur et moi avions tous deux une activité d’enseignants chez Epitech, notre ancienne école, ce qui nous donnait accès à un vivier de talents juniors, dans les écoles.
Nous étions 4 personnes au départ, contre 27 aujourd’hui : nous avons recruté un spécialiste du Marketing et un spécialiste de Design. Ensuite nous sommes allés chercher des profils techniques pour faire grandir le produit.
Nous avons souhaité dès le début insufflé une culture très pédagogique dans l’entreprise. Plus tard, nous nous sommes posé la question du ratio idéal entre juniors et seniors. C’est une question que nous avons exploré avec intérêt et sans trouver de règle absolue, si ce n’est la conviction qu’il est très efficace de mêler ces deux profils. Nous essayons aussi de maintenir un ratio de 20% de femmes dans l’équipe Tech (33% dans l’entreprise), pour créer un cercle vertueux.
La difficulté reste toujours de trouver les talents : nous n’y arrivons pas sans recruteur. Nous avons engagé une chargée de RH, mais c’est difficile avec une telle diversité de compétences. Son rôle est de synchroniser les recruteurs. Et de veiller à ce que nous intégrions des collaborateurs « teachables » : en accord avec notre culture d’entreprise. Son poste est d’ailleurs intitulé “People & Culture Manager” ».
Yvan Measson, co-fondateur d’Isybot
« J’ai monté un comité stratégique avant de créer l’entreprise »
« L’équipe-cœur, chez nous, c’est le directeur technique et moi-même. Je l’ai recruté quand j’étais chef de labo au CEA et je l’ai emmené avec moi ensuite dans l’aventure de la création d’entreprise. Il était donc parfaitement formé au moment de fonder Isybot. En parallèle, j’avais anticipé ce besoin de construire une équipe très forte dès le début, au point d’ailleurs qu’on me l’a reproché : on m’a dit que je mettais la charrue avant les bœufs car j’engageais des profils très expérimentés sur des sujets que j’estimais clefs, avec des salaires très importants. Je ne le regrette pas.
Nous construisons des robots, or un robot est un agglomérat de technologies et d’expertises. Il faut un panel large de compétences et la capacité de pénétrer le marché.
Dans le monde des DeepTech, on peut très vite sinon se retrouver enfermés dans une forme d’innovation perpétuelle, sans jamais vendre quoi que ce soit.
Pour ma part, j’avais constitué un comité stratégique, avant de fonder l’entreprise. Ils étaient tous bénévoles, certains sont devenus associés. J’avais réuni un profil expert en stratégie d’entreprise, un autre sur la sécurité des machines, un troisième sur le droit industriels, une avocate, un spécialiste des achats (le « Make or Buy ? » est essentiel pour nous) et un spécialiste du commerce et marketing. On se voyait tous les trois mois pour décider et valider des orientations prises.
Le premier qui m’a rejoint en tant qu’associé était le spécialiste du commerce et du marketing. La levée de fonds est arrivée rapidement après la création d’Isybot.
Aujourd’hui, nous sommes 18. J’estime n’avoir pas encore besoin de DRH. Pour trouver des talents, nous passons par des cabinets de recrutement – les plateformes apportent trop de candidatures farfelues. Et pour le reste, je m’en occupe moi-même. Je crois que c’est à moi qu’il incombe de donner une vision, pas à un DRH. »

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique