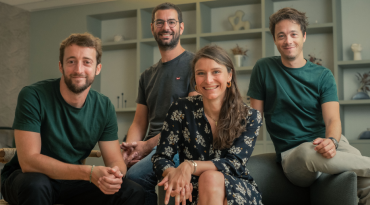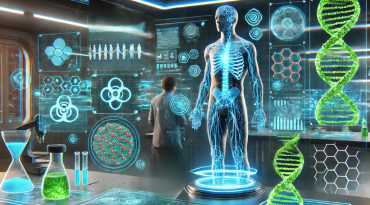Lauréat 2010 de la médaille Fields, l’équivalent des prix Nobel pour les mathématiques, le Français Cédric Villani estime que la France ne forme pas assez de matheux pour répondre aux besoins de l’industrie numérique.

Cédric Villani Directeur de l’institut Henri-Poincaré © Sébastien Godefroy/IHP
Alliancy, le mag. Quelle est la place réelle occupée par les mathématiques dans la transformation numérique ?
Cédric Villani. La mathématique est toujours le substrat des algorithmes qui font tourner les programmes informatiques. Et il est clair que la mathématique joue un rôle croissant dans ce qui constitue l’économie virtuelle au sens large. Le métier de mathématicien est projeté comme l’un des métiers à plus forte croissance dans les années à venir, et le métier clé dans un environnement où ne sait pas trop comment va évoluer le marché du travail. Avec la transformation numérique les cadres de travail vont être rebattus avec, selon moi, cette seule certitude : il y aura du travail pour les mathématiciens.
Comment jugez-vous l’approche qu’ont les grandes écoles et universités de cette économie ?
C’est très variable et cela dépend beaucoup des cultures de ces écoles. Certaines se sont engouffrées dans la brèche en ouvrant des filières big data, thème qui est le plus en rapport avec la mathématique au sens large. Cela veut dire beaucoup de statistiques, certaines bases en géométrie, en analyse et en probabilité et puis la possibilité de travailler sur des formats informatiques et la manipulation de données énormes. Certaines écoles comme Mines ParisTech, Polytechnique, ont bien pris le virage en couplant leurs ressources intérieures afin de créer leur filière, mais il est vrai que d’autres, je ne citerai pas de noms, restent dans une posture attentiste sur ce sujet.
Et côté entreprises ?
C’est un peu la même chose. Certaines ont axé un recrutement sur des mathématiciens de niveau doctorat. D’autres restent sur un modèle plus classique… Mais les grandes multinationales connaissent la qualité de l’école mathématique française. Quand l’an dernier, Huawei, le leader mondial de l’électroménager, a ouvert à Sophia-Antipolis un centre de R&D mondial [pour sa division téléphonie mobile, Ndlr] elle a ouvert le recrutement de 70 docteurs en mathématiques.
L’économie numérique a chamboulé notre façon d’innover. Aujourd’hui, les solutions semblent d’abord venir des métiers ?
Si l’idée vient des métiers, le développement, lui, se nourrit des travaux académiques. Je dirais donc qu’il y a toujours une interaction entre les deux.
Des sociétés, telles que celles de l’industrie pétrolière qui est en forte demande d’analyse de données, vous contactent-elles ?
Vous avez raison de donner cet exemple, car l’un des plus gros centres de calculs en Europe est celui du groupe pétrolier Total, situé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces groupes nous approchent pour nous demander de monter des formations en partenariat de recherche et en même temps, nous aussi car nous sommes en demande de soutien financier. Il y a une volonté qui va dans les deux sens même si ce n’est pas le modèle traditionnel français.
Que manque-t-il selon vous pour former de bons data scientists ?
En France, je dirais qu’il manquait surtout deux choses : d’une part, la volonté de faire. Cela peut provoquer de véritables déchirements dans les départements d’enseignement. Et d’autre part, le contact avec les sujets tels que tirés de la vie réelle. Pour former un data scientist, il ne suffit pas de travailler sur des théorèmes. Il faut aussi travailler sur des cas concrets. Ce rapport entre l’académique et l’industrie n’est pas, historiquement, une force française, mais il ne manque aujourd’hui pas grand-chose pour que cela fonctionne très bien. Bien sûr, tout le monde tâtonne un peu, académiques comme industriels, mais les formations sont des choses longues à mettre en place. Or, nous sommes là, tous, sur quelque chose de très nouveau. Le problème pour l’université, c’est vraiment l’approvisionnement en étudiants.
Il n’y a pas assez de matheux ?
Effectivement, il n’y a plus assez de matheux pour répondre aux besoins de certaines filières, notamment dans la statistique. Les jeunes sont trop rapidement happés par l’industrie, souvent avant la thèse. Or, on le voit, je donnais l’exemple de Huawei, beaucoup d’entreprises internationales sont en recherche de docteurs. L’une des conséquences de l’attractivité de l’industrie est donc un déficit en enseignants-chercheurs dans certaines disciplines, ce qui n’est pas bon pour nos formations.
L’industrie est-elle la seule fautive ?
Non. Nous avons des problèmes de recrutement en amont. Certaines filières sont bondées, comme en médecine ou en école de commerce. D’autres, comme la filière mathématique, ne recrutent pas assez. Le métier de chercheur en science fondamentale est perçu comme une carrière à risques.
Pourquoi ?
D’une part, parce que cela semble déconnecté du monde extérieur et d’autre part, parce qu’avant d’appliquer les algorithmes, il faut commencer par les travailler. Et, c’est un métier où vous reposez sur votre créativité, et votre faculté à trouver une nouvelle solution dont vous n’êtes pas sûr. La mathématique est donc une filière à risque. A contrario, c’est une filière où il y a des débouchés et où l’on attend une explosion de la demande dans des métiers à forte valeur ajoutée, comme le big data. Ce sont des études difficiles mais qui constituent un vrai investissement pour l’avenir.
Les filles sont réputées plus brillantes étudiantes que les garçons, or elles sont moins nombreuses qu’eux à prétendre à un doctorat. Qu’en pensez-vous ?
La question se pose effectivement. Beaucoup se dirigent vers un doctorat… mais de médecine [où elles sont majoritaires, Ndlr]. Or, les filières sont bondées et la sélection considérable alors qu’en mathématique, les sélections sont beaucoup moins sévères.
Comment motiver les jeunes ?
C’est une question culturelle et donc beaucoup plus longue à changer qu’une solution technologique. Faire adopter aux gens un iPhone se fait en un claquement de doigt, pour changer des clichés, il faut des années. C’est la fameuse phrase d’Einstein : « Il est plus facile de casser un atome qu’un préjugé. » Ça ne se décrète pas. C’est toute la société qui doit bouger. Tant sur les plans de l’enseignement, le plan politique, médiatique, que culturel. C’est une action d’ensemble.
Sur cette question de la présence féminine dans les filières scientifiques de haut niveau, est-ce la même chose partout dans le monde ?
Non, c’est très variable d’une culture à l’autre. Il est d’ailleurs très intéressant de noter que le nombre de femmes se lançant dans des carrières scientifiques en Europe stagne depuis longtemps, comme en Asie. Cela diminue en Amérique latine, mais augmente au Moyen-Orient. A chaque fois que j’ai pu faire des interventions au MoyenOrient, j’ai pu constater que les femmes étaient les plus motivées.
Un esprit décoiffantC’est une incarnation, presque un cliché, de l’esprit français. Dandy affublé d’une lavallière de soie, coupe de cheveux néoromantique, et énorme araignée à la boutonnière… Cédric Villani ne passe pas inaperçu dans le monde feutré de la recherche universitaire. Communicant et soucieux de rafraîchir l’image véhiculée par les mathématiques, le quadragénaire médaillé de Fields ne compte pas ses heures devant les écoliers et lycéens pour les sensibiliser à l’importance de cette science. Directeur de l’Institut Henri-Poincaré (université Pierre et Marie Curie) et professeur à l’université de Lyon 1, il est également professeur Honoris Causa à HEC. Depuis un an, il développe le projet de créer à Paris un musée dédié aux mathématiques. Curieux des initiatives locales en la matière, il était fin décembre dans le Gard pour rencontrer Eurek’Alès, une association de vulgarisation scientifique tournée vers les scolaires, parce que, conclut-il : « Les bonnes idées viennent du toujours du terrain. » Lire aussi son blog : http://cedricvillani.org |

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique