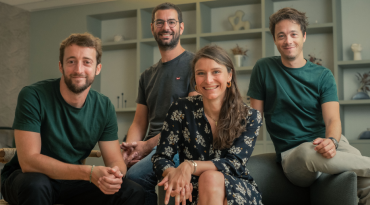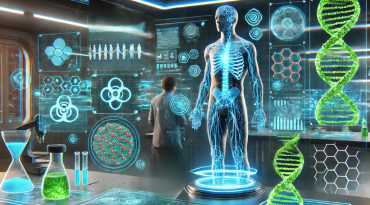Ÿnsect concrétise la synthèse entre le monde de l’entrepreneuriat et la recherche. Aujourd’hui membre du Next40, la start-up spécialisée dans l’élevage d’insectes est née en 2011 d’une entente entre Antoine Hubert (AgroParisTech), Jean-Gabriel Levon (HEC Paris, Polytechnique), Fabrice Berro (Ensimag) et Alexis Angot (Essec). Alliancy s’est entretenu avec le CEO Antoine Hubert afin de partager ses conseils pour monter en puissance un projet de recherche grâce à la sphère privée.
Alliancy. Votre projet est essentiellement de répondre à la demande du marché de la nutrition d’animaux domestiques et d’élevage en exploitant les protéines et lipides des insectes. Mais, en dix ans d’activité, vous avez levé plus de 175 millions d’euros, déposé plus de 25 brevets et aujourd’hui vous embauchez plus d’une centaine de salariés … Quelles sont les nouveautés pour votre activité ?
Antoine Hubert. Nous sommes traditionnellement centrés sur la nutrition pour l’aquaculture et les animaux domestiques. Mais nous proposons désormais des aliments pour les animaux d’élevage et de l’engrais pour les plantes. Nous sommes capables de mettre à disposition notre savoir technologique à plusieurs filières industrielles et grands groupes.
Notre produit Ynmeal par exemple, est une poudre protéinée et dégraissée conçue à partir de larves de vers de farine qui a été choisie par Skretting, un des leaders de la nutrition des poissons. Notre engrais naturel Ÿnfrass est utilisé par le vignoble espagnol Torres pour augmenter ses rendements et la qualité de son vin.
Début 2021, l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) nous a donné le feu vert pour investir un nouveau marché : l’Efsa a délivré un avis positif sur l’utilisation du ver de farine pour l’alimentation humaine. Cela nous a permis d’annoncer que nous nous lancions également dans le secteur de l’alimentation humaine avec un ingrédient à base de protéines d’insectes déshuilés.
Votre scalabilité dépend donc beaucoup des partenariats avec les gros acteurs de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution… Lesquels vous ont permis de monter en puissance ?
Antoine Hubert. Depuis le début, nous étions proches de Bpifrance. Et c’est en partie grâce à leurs services que nous avons remporté en 2012 le grand Prix de l’Innovation de la Ville de Paris et le concours mondial de l’Innovation. Bpifrance nous a notamment accompagné sur le volet R&D et est devenu actionnaire par le biais de ses fonds Ecotechnologies et Large Venture. L’accès à l’écosystème de Bpifrance nous a permis de rencontrer des acteurs de différents secteurs et de toutes tailles.
Nous avons ensuite développé plusieurs collaborations pour gagner en puissance. Technip nous a par exemple aidé à structurer notre projet de construction de la plus grande ferme verticale d’insectes au monde à Amiens. Le projet Farmying est d’ailleurs cofinancé par la Commission Européenne et le Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) à hauteur de 20 millions d’euros. Cette grande usine automatisée est l’aboutissement de tous nos développements technologiques de ces dernières années et permettra de produire à terme 200 000 tonnes de farine d’insectes par an.
Nous n’aurions pas pu devenir une scale-up aussi rapidement sans tout cet écosystème. Mais il ne faut pas oublier qu’avant d’y arriver, il faut s’allier à de plus petits acteurs. Avant d’ouvrir son écosystème aux grands comptes, il y a plusieurs pièges d’organisation et de développement à éviter.
Nos partenaires fournisseurs, PME, ETI et start-up sont toujours présents pour assurer le travail d’instrumentation, de mécanique et de maintenance de nos sites industriels. C’est d’autant plus primordial à Amiens car ce projet représente 150 millions d’euros d’investissements, est 100 fois plus productif et 2 fois plus coûteux.
Depuis le lancement de son plan Deeptech il y a trois ans, Bpifrance affirme que la collaboration entre les start-up du domaine et les grands comptes est effective. Êtes-vous d’accord avec cela ?
Antoine Hubert. Le monde de la recherche a été inclus dès le début du plan Deeptech ; les laboratoires d’Inria et du CNRS y sont bien présents. Et le transfert technologique semble aller dans le bon sens : aujourd’hui, 20 % des entreprises du classement FrenchTech 120 sont industrielles. Ce n’était pas le cas auparavant.
Il faut continuer cette progression car cela permettra d’adresser de nombreux enjeux liés à notre souveraineté européenne dans le domaine agroalimentaire ou celui de la santé, voire dans notre filière d’extraction minière. L’idée n’est pas d’adopter une posture « anti-globalisation », mais de devenir moins dépendants de nos importations. La Deeptech peut nous offrir plus d’autonomie et remplir des objectifs de réindustrialisation.
De la même manière, le développement de start-up industrielles européennes est à mon sens la clé pour réduire l’impact écologique de l’industrie. Il faudra pour cela s’en remettre à l’échelon local et favoriser le développement de start-up et d’usines dans nos territoires.
Il n’y a pour autant pas encore de licornes européennes Deeptech en vue…
Antoine Hubert. Le fonctionnement pour faire émerger un écosystème Deeptech en France et en Europe n’est pas encore optimal. Il prend du temps à se former. À l’instar des entrepreneurs de la Silicon Valley, nous n’avons pas bénéficié de fonds conséquents de l’Armée. Ces milliards de dollars irrigués historiquement par la Darpa ont en partie grandement permis d’alimenter les projets de recherche américains et ainsi faire émerger les Gafam que l’on connaît aujourd’hui.
Il faut porter à bout de bras notre écosystème de start-up. Il y a eu ces dernières années beaucoup d’amorçages conséquents en France et en Europe. Mais il y a encore peu de gros bouclages et cette tendance s’accentue avec la crise. Quoiqu’il en soit, le secteur Deeptech est porteur depuis deux ans dans l’innovation de rupture. Il manque juste d’un peu plus de soutien de la part des grands groupes industriels.
C’est d’ailleurs ce que veut pousser Bpifrance en annonçant récemment une alliance entre la French Tech et la French Fab ?
Antoine Hubert. Les grands groupes et les filières industrielles doivent plus s’impliquer dans le développement de la Deeptech française. Il y a encore une acculturation à développer sur la relation qu’il est possible d’entretenir avec les start-up du domaine. Et c’est bien ce que Bpifrance entend accélérer avec le rapprochement de la French Tech et la French Fab et le lancement de la plateforme “Tech in Fab”. L’objectif est de donner envie aux jeunes de créer des start-up Deeptech.
Pour en savoir plus sur ces annonces : Industriels et Deeptech : de nouveaux outils à foison
Le croisement entre entreprises de la Tech et industrielles devient de plus en plus fort car le numérique permet d’amener l’industrie vers une autre échelle. Les Gafam ont par exemple permis de sécuriser l’approvisionnement de nombreuses grandes industries. Néanmoins, les technologies Deeptech sont gourmandes en capitaux et certaines industries manquent de fonds pour s’armer d’équipes de start-up à même d’apporter des innovations de rupture.
Face aux géants technologiques, la concurrence reste rude et le client choisit souvent le meilleur produit et la meilleure garantie de stabilité. Mais avec l’irruption de la Covid, nous remarquons une réelle dynamique autour du local. Les grandes industries cherchent de plus en plus des collaborations de proximité et il faut leur donner les moyens de faire cette mise en relation. Le numérique peut déjà aider à dématérialiser cette démarche et il y a peut être d’autres mécanismes à penser pour convaincre. Ce travail pourrait être envisagé auprès des assureurs et des fonds de garantie pour rassurer les industries sur leur choix de collaborer avec des acteurs européens..
En plus de la plateforme “Tech in Fab”, Bpifrance a aussi annoncé l’officialisation du club “Tech Factory”, réunissant 18 CEO de start-up. Quel est le but de cette démarche ?
Antoine Hubert. France Industrie réunit plusieurs groupes industriels et prévoit des mécanismes pour intégrer les start-up. Mais on y est pas encore. L’objectif du club “Tech Factory” est de faire rencontrer des CEO de start-up pour partager leurs difficultés ainsi que pour échanger plus librement sur leurs enjeux de développement et les bonnes pratiques à suivre. C’est aussi l’occasion, ensemble, de pousser des agendas réglementaires favorables à nos intérêts et d’identifier les freins encore existants.
Enfin, la perspective territoriale est aussi importante à relever car les enjeux divergent souvent en fonction de l’implantation de la start-up et les verticales sur lesquelles elles se focalisent. Ce réseau officiel des start-up industrielles n’existait pas ou était uniquement réservés aux grands groupes.
Quels conseils donneriez-vous aux start-up qui aspirent à devenir des Deeptech ?
Antoine Hubert. Comme je le disais, former un écosystème prend du temps, surtout dans l’agroalimentaire. Au début de leur développement, les PME et les ETI doivent penser leur stratégie autour de cet objectif pour espérer monter en puissance. Il faut d’abord commencer par plus petit et favoriser le fonctionnement agile pour ensuite, se rapprocher de grands groupes. Les start-up doivent bien choisir leur client et montrer leurs réussites pour décrocher d’autres collaborations.
Mais c’est une erreur de viser des grands partenariats dès le début car cela peut poser problème pour garantir la stabilité de la trésorerie. D’autant plus qu’il est souvent compliqué d’obtenir des garanties de paiement de commandes de la part des grands groupes. Or, pour beaucoup de start-up, un mois d’attente de paiement peut avoir de sérieuses conséquences en termes de “cash burn”.
Les laboratoires rencontrent aussi ce même problème car ils ne vivent pas non plus sur le même tempo que les grandes organisations. Quand un grand groupe fait des ajustements pour l’ensemble de ces partenaires, cela impacte tout l’écosystème et l’adaptabilité demeure plus difficile. Ajoutez à cela les objectifs de publications scientifiques et de propriété intellectuelle qui reste le nerf de la guerre entre tous les laboratoires. Il faut trouver un moyen de s’entendre sur ce sujet pour favoriser le transfert technologique à partir de brevets scientifiques.
Il y a également l’acculturation des jeunes chercheurs aux projets Deeptech…
Antoine Hubert. C’est un autre enjeu en effet et c’est ce que fait Hello Tomorrow depuis trois ans avec un programme en partenariat avec Bpifrance et sous le patronage conjoint du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Ministère de l’Economie et des Finances. Cette formation à l’entrepreneuriat Deeptech est destinée aux chercheurs de toutes disciplines.
Le fait est qu’un chercheur est aussi un entrepreneur par nature, car dans le cadre de ses projets de recherche, lui aussi est amené à piloter des équipes et à trouver des financements. Il lui faut juste un déclic pour porter les expérimentations hors de son laboratoire et se rapprocher de la sphère privée. Les associations entre ingénieurs et étudiants d’écoles de commerce sont très importantes dans ce cas pour faire comprendre aux jeunes chercheurs qu’ils sont déjà dans une démarche entrepreneuriale. La recherche a besoin de cette pédagogie autour de la culture entrepreneuriale.
Le plan Deeptech initié par le gouvernement et conduit par Bpifrance traduit une volonté politique forte de faire rayonner la recherche française et créer l’emploi de demain. La dernière étape de ce programme vise la création de géants Deeptech au CAC40. Cela implique de sensibiliser les entrepreneurs au fait de ne pas céder trop tôt à la revente de leur projet. Si une start-up se base sur une innovation de rupture, ses chances de devenir une licorne sont d’autant plus grandes.

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique