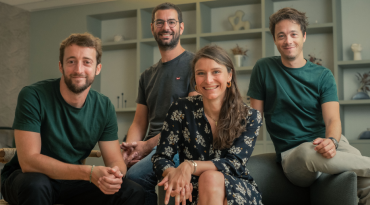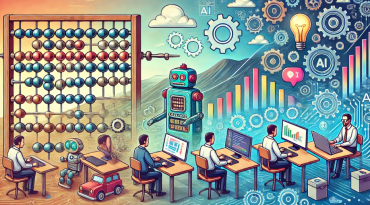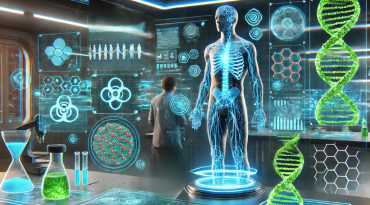[Billet d’humeur] Le musée du Jeu de Paume accueille l’exposition « Le monde selon l’IA » jusqu’en septembre 2025. De quoi respirer et prendre le sujet, le temps d’une visite, à revers.
L’intelligence artificielle fait peur. On comprend. Promesses de remplacement massif, hallucinations numériques, désinformation à grande échelle, sans parler du sempiternel fantasme du robot plus intelligent que son créateur. Dans l’imaginaire collectif, l’IA ressemble de plus en plus à un ogre élégant : discret, puissant, insaisissable.
Et pourtant, au Jeu de Paume, l’exposition Le Monde selon l’IA propose un tout autre récit. Pas celui du progrès triomphant, ni de l’apocalypse technologique, mais un récit fait d’interrogations, de détours, et même – disons-le – d’humanité.
À travers une sélection d’œuvres contemporaines, des artistes comme Kate Crawford, Trevor Paglen ou Hito Steyerl choisissent de prendre l’IA non comme une vérité révélée, mais comme une matière à penser. Les allées du centre d’art du jardin des Tuileries sont actuellement parsemées d’œuvres qui triturent les algorithmes, les décomposent, les démasquent. Certaines sont techniques, d’autres presque poétiques. L’ensemble dessine un paysage mouvant, fait d’inquiétude mais aussi de lucidité.
L’exposition distingue notamment deux types d’IA : l’analytique (celle des reconnaissances faciales, des prédictions, des classements) et la générative (celle qui crée des images, des textes, des vidéos). Et, si la seconde fascine aujourd’hui, à coups de peintures « créées par une machine » ou de romans « coécrits par un algorithme », elle suscite aussi, dans le regard des artistes, une forme de résistance critique : que fabriquons-nous vraiment avec ces outils ? Et pour qui ?
En prenant l’IA au sérieux, mais sans la sacraliser, Le Monde selon l’IA rappelle que l’enjeu n’est pas d’avoir peur ou d’embrasser la technologie les yeux fermés. L’enjeu, c’est d’en parler, de la regarder en face, d’en faire un sujet de débat culturel autant que scientifique. Et c’est peut-être là la meilleure manière de sortir du climat anxiogène qui entoure souvent ce sujet.
Non, l’IA n’est pas une boîte noire magique. Elle n’est pas non plus le début de la fin. Elle est un outil, un miroir, parfois un révélateur. Et entre de bonnes mains – humaines, critiques, créatives – elle peut devenir autre chose qu’une menace : une occasion de mieux comprendre le monde.

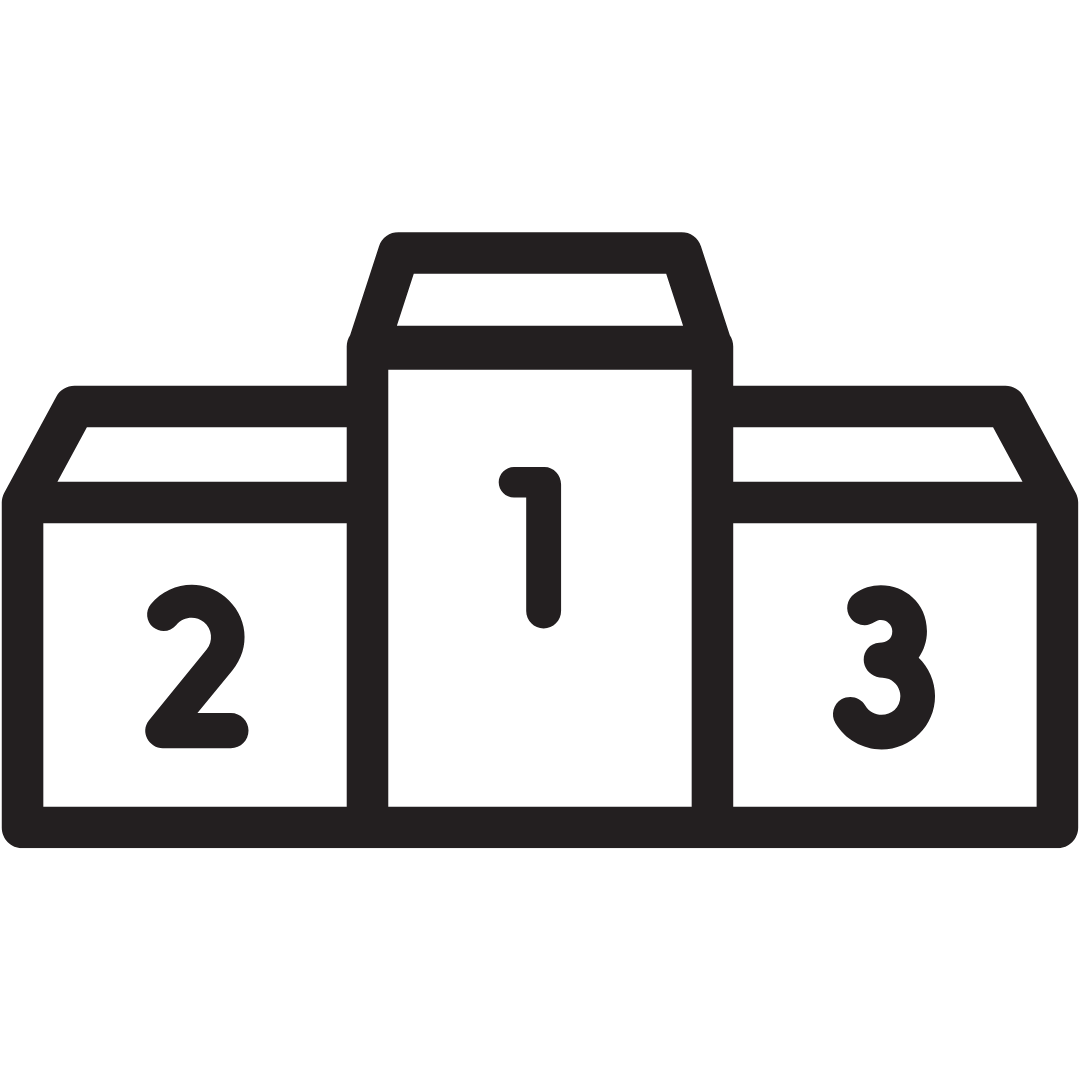 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique