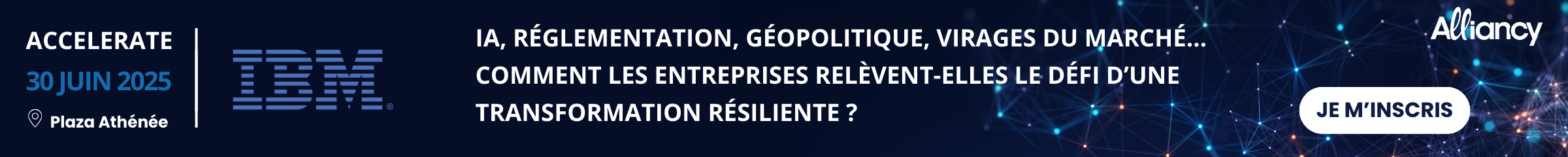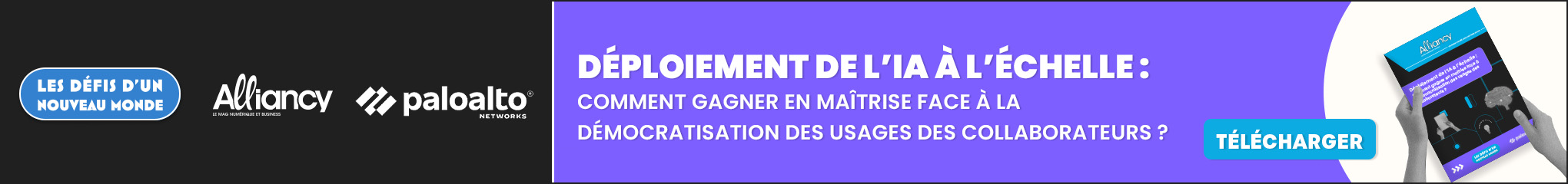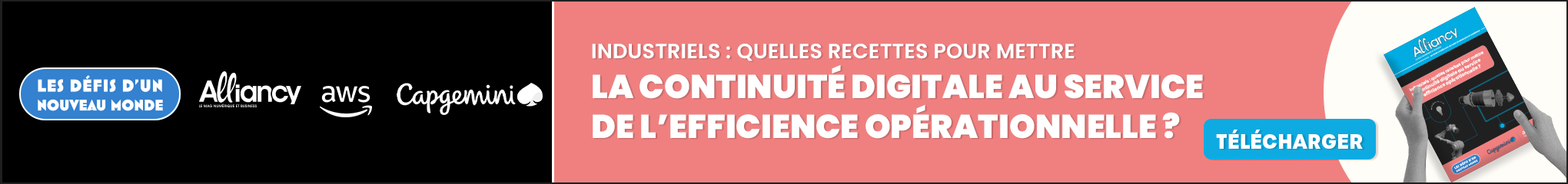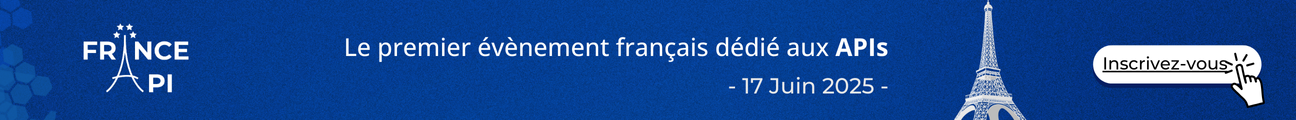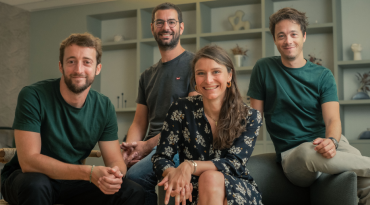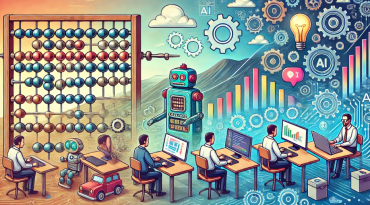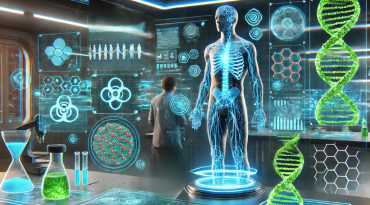En s’interrogeant sur la faible représentation persistante des femmes dans le numérique, notre chroniqueur Imed Bougzhala en profite pour remettre un coup de projecteur sur ces nombreuses expertes qui ont « changé le cours de l’Histoire » en construisant le numérique. Il souligne aussi le rôle des écoles françaises pour sortir de la tendance actuelle.
Le digital est au cœur des transformations économiques, sociales et culturelles de notre époque. Il redéfinit les métiers, bouleverse les secteurs d’activité et impacte profondément nos vies au quotidien. Pourtant, malgré son omniprésence, il souffre d’un déséquilibre notable : les femmes y sont largement sous-représentées[1]. Ce constat soulève une question fondamentale : pourquoi avons-nous besoin de davantage de femmes dans le digital ?
Une question d’équité et de diversité
La faible représentation des femmes dans le digital n’est pas uniquement un enjeu de parité, mais un problème d’équité. Alors que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale et une grande partie des consommatrices des produits technologiques, elles ne participent pas à parts égales à leur conception ou à leur développement.
Cette sous-représentation crée un biais dans la manière dont les technologies sont pensées et conçues. Des algorithmes discriminants aux outils non inclusifs, l’absence de diversité dans les équipes de développement conduit à des solutions qui ne répondent pas pleinement aux besoins de la société dans sa diversité. Pourtant, l’histoire nous montre que lorsque les femmes participent à la construction du numérique, elles changent le cours de l’Histoire.
Par exemple, Ada Lovelace (1815 – 1852) est considérée comme la première programmeuse de l’histoire. Dès le XIXe siècle, elle a anticipé les capacités des ordinateurs modernes en écrivant le premier algorithme destiné à une machine. Plus tard, Grace Hopper (1906 – 1992) a contribué au développement des premiers langages de programmation accessibles, notamment COBOL, facilitant ainsi l’usage des ordinateurs. Elle est également créditée d’avoir popularisé le terme « bug » en informatique.
Une opportunité pour l’innovation et la créativité
La diversité est un moteur puissant de l’innovation. De nombreuses études montrent que les équipes mixtes, composées d’hommes et de femmes, obtiennent de meilleurs résultats en termes de créativité, de résolution de problèmes et de performance globale. Les femmes apportent une vision et une approche souvent différentes, qui enrichissent le processus de création et d’innovation.
La créativité constitue une force naturelle chez de nombreuses femmes. Leur capacité à penser différemment, à questionner les modèles établis et à imaginer des solutions nouvelles apporte une véritable plus-value dans le digital. En combinant approche scientifique et pensée créative, elles parviennent à réinventer les usages, les outils et les technologies.
Un exemple frappant est Hedy Lamarr (1914 – 2000), à la fois actrice et inventrice, qui a co-inventé le système de « saut de fréquence », à la base des technologies Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Sa démarche illustre parfaitement le croisement entre créativité, intuition et innovation technologique. Aujourd’hui, cette capacité à imaginer des solutions originales est particulièrement recherchée dans des domaines comme l’intelligence artificielle, le design numérique et l’expérience utilisateur (UX).
Un impact particulier dans le domaine de la santé
Le secteur de la santé est l’un des domaines les plus transformés par l’innovation numérique, et les femmes peuvent y jouer un rôle central. Naturellement sensibles aux enjeux humains, elles ont la capacité de contribuer à des solutions technologiques qui améliorent la vie des patients, optimisent les diagnostics et transforment les parcours de soins.
Par exemple, les technologies telles que l’intelligence artificielle médicale, la télémédecine, les dispositifs connectés ou encore les applications pour le bien-être et la prévention sont des domaines où la présence féminine peut apporter une dimension éthique et inclusive essentielle. En intégrant la créativité, la rigueur scientifique et une sensibilité humaine, les femmes permettent de développer des innovations qui répondent véritablement aux besoins des patients.
Certaines pionnières comme Fei-Fei Li, experte en intelligence artificielle, travaillent aujourd’hui sur des systèmes capables de révolutionner le diagnostic médical, tandis que des chercheuses françaises telles que Laurence Devillers s’intéressent aux interactions homme-machine pour créer des solutions plus adaptées et éthiques dans le secteur de la santé.
Répondre à la pénurie de talents
Le secteur du digital fait face à une pénurie mondiale de talents. Les entreprises peinent à recruter les compétences dont elles ont besoin pour développer leurs activités. Selon certains rapports, des centaines de milliers d’emplois dans le numérique restent vacants chaque année en Europe.
Dans ce contexte, attirer davantage de femmes vers les carrières digitales est une solution évidente pour combler cet écart. Des figures comme Margaret Hamilton (1936 -), qui a développé les logiciels permettant à Apollo 11 d’alunir, montrent que les femmes disposent des compétences techniques et de la créativité nécessaires pour relever les plus grands défis numériques. Leur inclusion permettrait non seulement de répondre à la demande croissante de compétences, mais aussi de diversifier les profils et d’apporter des approches complémentaires dans un domaine où la standardisation des parcours est encore trop courante.
Inspirer les futures générations
Le manque de modèles féminins dans le digital constitue un frein pour les jeunes filles et femmes qui pourraient envisager une carrière dans ce domaine. Lorsque les rôles de leadership, les figures médiatiques ou les experts techniques sont majoritairement masculins, il devient plus difficile pour les femmes de se projeter dans ces carrières.
Des femmes comme Katherine Johnson (1918 – 2020) et Joan Clarke (1917 – 1996) sont des exemples inspirants. Katherine Johnson, mathématicienne de génie, a calculé les trajectoires des missions Apollo pour la NASA, contribuant à des avancées historiques. Joan Clarke, quant à elle, a joué un rôle clé dans le déchiffrement des codes Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés d’Alan Turing. Leur travail, longtemps resté dans l’ombre, prouve que les femmes peuvent exceller dans les domaines les plus techniques tout en apportant une vision unique et souvent créative. Leur histoire met en lumière la contribution des femmes dans l’histoire de l’informatique et des mathématiques appliquées.
Il serait impensable de ne pas mentionner Radia Perlman (1951 – ), surnommée la « mère d’internet », qui a inventé l’algorithme du Spanning Tree Protocol (STP), essentiel à la construction de réseaux informatiques robustes et évolutifs. À ses côtés, Annie Easley (1933 – 2011), informaticienne afro-américaine et pionnière à la NASA, a ouvert la voie aux femmes issues de minorités dans les domaines des sciences et de l’ingénierie. Enfin, Shafi Goldwasser (1958 – ), informaticienne et cryptographe de renom, est saluée pour ses contributions majeures à la cryptographie et à la théorie de la complexité algorithmique, et a été honorée à deux reprises du prix Turing, souvent considéré comme le « Nobel de l’informatique ».
En France aussi, des femmes façonnent le numérique
Si les pionnières mondiales du numérique comme Ada Lovelace ou Grace Hopper sont souvent citées, la France n’est pas en reste et compte des femmes qui marquent ou ont marqué durablement le secteur du numérique, pour ne citer que quelques figures contemporaines :
- Aurélie Jean, scientifique et entrepreneuse, sensibilise aux enjeux des algorithmes et milite pour une meilleure éducation numérique.
- Laurence Devillers, chercheuse en intelligence artificielle, travaille sur l’IA éthique et les interactions homme-machine, notamment dans la santé.
- Roxanne Varza, directrice de Station F, accompagne les startups françaises et promeut l’entrepreneuriat féminin dans la tech.
- Marie Ekeland, investisseuse et cofondatrice du fonds d’investissement Daphni, soutient l’innovation numérique en France et en Europe.
- Isabelle Collet, informaticienne et chercheuse, lutte contre les stéréotypes de genre dans les métiers du digital.
- Stéphanie Delestre, fondatrice de la plateforme Qapa, est une figure de la French Tech en matière de recrutement numérique.
- …
Ces femmes (parmi tant d’autres) sont des exemples concrets du rôle essentiel des talents féminins dans l’innovation technologique et digitale en France. Elles prouvent que les femmes françaises contribuent activement à façonner le numérique d’aujourd’hui et de demain, en apportant des idées nouvelles et une créativité essentielle pour relever les défis technologiques, notamment dans des secteurs à fort impact comme la santé.
Le rôle des écoles françaises
L’intégration des femmes dans le digital est une nécessité, non seulement pour répondre aux besoins croissants du secteur, mais aussi pour construire un monde numérique plus juste, plus innovant et plus inclusif. La combinaison de leur rigueur scientifique, de leur capacité créative et de leur sensibilité aux enjeux humains permet de repenser les usages et les technologies avec une approche plus humaine et plus équilibrée.
Des pionnières historiques comme Ada Lovelace et Hedy Lamarr aux figures françaises comme Rose Dieng-Kuntz (1956 – 2008), les femmes ont prouvé qu’elles sont capables de transformer la technologie et d’inspirer les futures générations. Il est temps de valoriser leurs contributions, d’encourager les jeunes filles à s’engager dans le numérique et de reconnaître que la mixité, la créativité et la sensibilité aux enjeux humains sont des conditions essentielles pour l’innovation et la performance du secteur.
Dans le milieu des écoles d’ingénieurs françaises, la place des femmes dans le secteur de la tech est une préoccupante (en moyenne de 18%). Elle est au cœur de l’approche de l’ensIIE (crée en 1968), notamment à travers son programme « L’ensIIE au féminin« . Parmi les actions pour favoriser la présence des femmes : déconstruire les stéréotypes dès l’école primaire, multiplier les modèles féminins pour inspirer et motiver, soutenir les parcours féminins par le mentorat et impliquer les entreprises en instaurant des environnements inclusifs.
[1] « En 1982, 35 % des emplois d’informaticiens en France sont occupés par des femmes. Aujourd’hui l’importance du traitement et de l’analyse des données et l’avènement de l’intelligence artificielle font que seulement 12 % de femmes travaillent dans ce secteur en France » d’après [1]

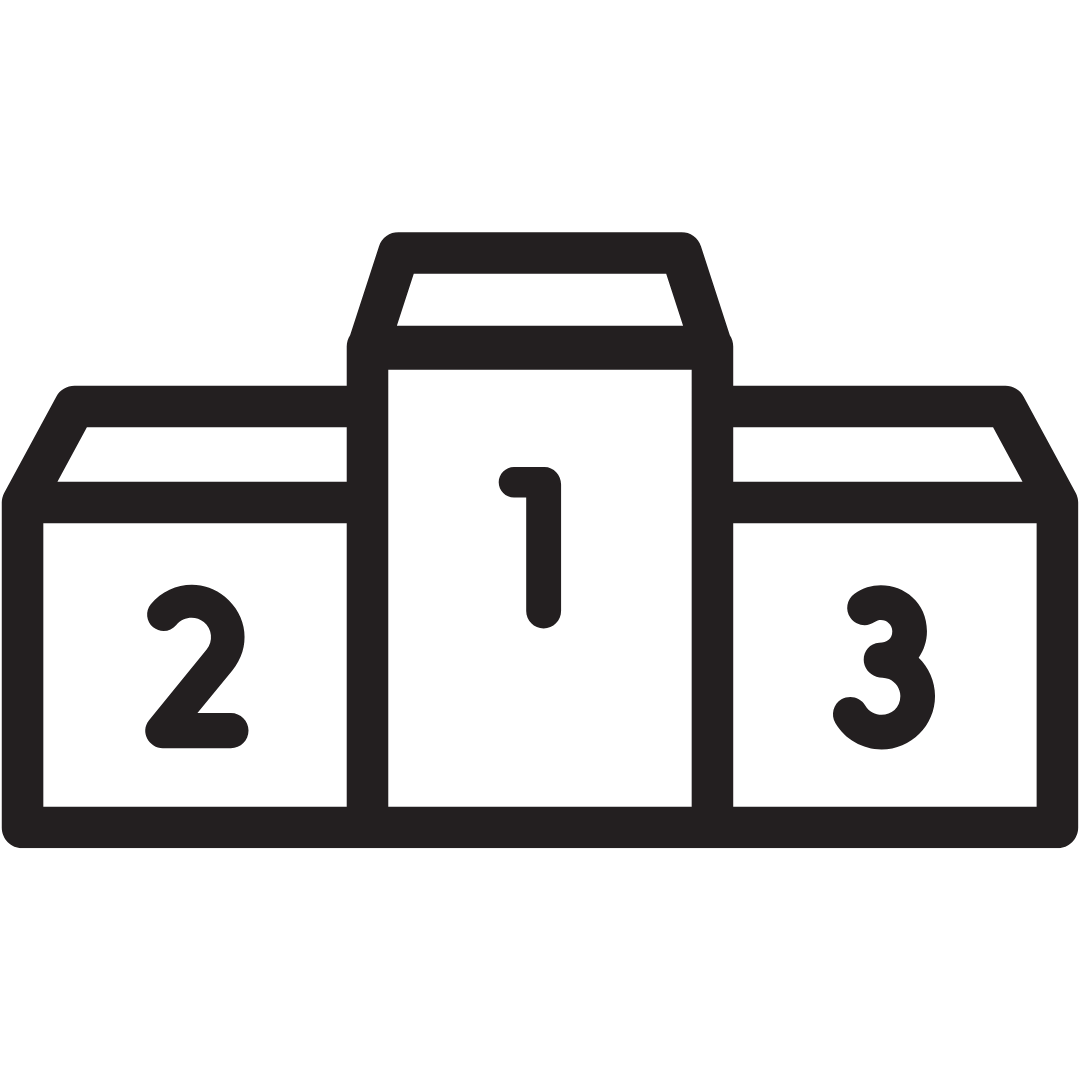 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique