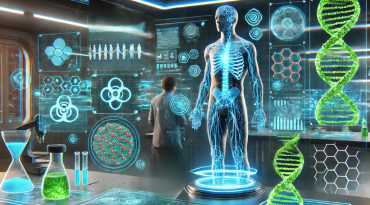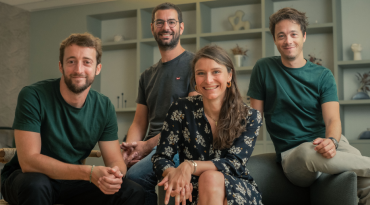La société française Criteo est le modèle à suivre pour de nombreux entrepreneurs du numérique. Fin 2013, le leader du ciblage publicitaire est entré avec succès au Nasdaq, aux Etats-Unis. Il vise aujourd’hui l’Asie
Pourquoi, dans le numérique, depuis trois décennies, si peu de start-up françaises ont-elles réussi à atteindre une taille vraiment significative ? Quels sont les freins à la croissance ? Cinq patrons français du logiciel donnent leur point de vue.
Cela avait bien commencé. La France avait su profiter de la première vague informatique, celle des années 1960, celle du logiciel sur mesure. Cette époque a donné naissance à des géants d’envergure mondiale, des SSII (renommées depuis ESN pour entreprises de services du numérique) comme Capgemini ou Atos. Elles ont réalisé, respectivement, 10 et 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2012. La seconde vague, celle du progiciel, a été moins glorieuse. Ce n’est pourtant pas le manque de start-up qui est à incriminer. Durant les trois dernières décennies, il n’a pas manqué de très prometteuses jeunes pousses dans tous les domaines. Mais, quand elles n’ont pas succombé, lot normal de bien des start-up, la plupart de celles qui offraient un fort potentiel ont fini par être rachetées. Le plus souvent par des Américains, à l’exception de l’une des plus belles success story françaises, Business Objects. Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars et 6 700 personnes (2007), elle a fini dans le giron de l’allemand SAP. En soi, le rachat n’a rien de dramatique. Il fait aussi partie de la destinée normale des start-up. Et il apporte des quantités d’argent non négligeables : 6,8 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros) pour le seul Business Objects ! Seul problème – et qui n’est pas seulement français –, entre les disparitions et les rachats, il ne s’est quasiment pas trouvé de start-up capables de croître suffisamment pour se comparer aux géants mondiaux du secteur qui se sont créés pendant ce temps. Ils sont presque tous américains. En Europe, le seul mastodonte est SAP avec 16,8 milliards d’euros en 2013 (pour mémoire, Microsoft pèse 78 milliards de dollars – 57 milliards d’euros). En France, il n’y a guère que Dassault Systèmes (et Ubisoft dans le jeu vidéo) pour relever le gant avec « seulement » 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour le premier, 1,3 pour le second. L’industrie est si morcelée qu’à eux deux, ils représentent près de la moitié (44 %) du chiffre d’affaires cumulé des cent vingt premiers éditeurs français de logiciels ! Fait curieux d’ailleurs, mais significatif, ni l’un ni l’autre ne sont des start-up au sens strict, mais des entreprises familiales…
Neolane dans le giron d’Adobe La troisième vague, celle de la génération Internet, fera-t-elle mieux ? Quelques signes, notamment le succès de Criteo, laissent penser que l’avènement de grandes entreprises du numérique est encore possible. Mais, avant de s’y intéresser, il n’est pas inutile de revenir sur les raisons qui ont freiné la croissance des éditeurs hexagonaux. A cet égard, l’exemple de Neolane est vraiment instructif. Voici une start-up française, fondée en 2001, qui était devenue une ETI (entreprise de taille intermédiaire) de 350 personnes (dont 180 en France). Elle réalisait, en 2012, un tiers de ses ventes de 44 millions d’euros aux Etats-Unis. Pionnière en la matière, elle se situait aux avant-postes du marketing conversationnel, autrement dit du marketing via les outils numériques. Elle excellait en particulier sur le marketing multicanal (e-mail, Web, mobile, réseaux sociaux…), un secteur en plein boom. Bref, tous les éléments propres à en faire une superbe success story étaient réunis. On pouvait voir en elle un futur leader européen et, pourquoi pas, mondial. Las ! Elle a été achetée, en juillet 2013, par l’éditeur américain Adobe.
La troisième vague, celle de la génération Internet, fera-t-elle mieux ? Quelques signes, notamment le succès de Criteo, laissent penser que l’avènement de grandes entreprises du numérique est encore possible. Mais, avant de s’y intéresser, il n’est pas inutile de revenir sur les raisons qui ont freiné la croissance des éditeurs hexagonaux. A cet égard, l’exemple de Neolane est vraiment instructif. Voici une start-up française, fondée en 2001, qui était devenue une ETI (entreprise de taille intermédiaire) de 350 personnes (dont 180 en France). Elle réalisait, en 2012, un tiers de ses ventes de 44 millions d’euros aux Etats-Unis. Pionnière en la matière, elle se situait aux avant-postes du marketing conversationnel, autrement dit du marketing via les outils numériques. Elle excellait en particulier sur le marketing multicanal (e-mail, Web, mobile, réseaux sociaux…), un secteur en plein boom. Bref, tous les éléments propres à en faire une superbe success story étaient réunis. On pouvait voir en elle un futur leader européen et, pourquoi pas, mondial. Las ! Elle a été achetée, en juillet 2013, par l’éditeur américain Adobe.
 Que dit Stéphane Dehoche, ex-PDG et cofondateur de Neolane ? Tout d’abord, le premier handicap pour un éditeur français de logiciels, par rapport à un homologue américain, tient à la taille limitée du marché français et à la fragmentation du marché européen, ce qui freine sa croissance. Selon lui, si l’on prend deux entreprises équivalentes, l’une française, l’autre américaine, pour cette simple raison, « dans le même laps de temps, la première atteindra un chiffre d’affaires, par exemple, de 50 millions d’euros, quand la seconde plafonnera à 10 millions… » Deuxième handicap pour le français de l’étape : la valorisation en Bourse. La mise sur le marché est la voie royale pour favoriser le changement de dimension d’une start-up et financer sa croissance. Mais, note Stéphane Dehoche, « en France, la valorisation des entreprises de logiciels est très sous-estimée. Un facteur deux, voire trois, sépare la valorisation obtenue sur le Nasdaq de celle qu’une entreprise peut espérer en France ». Il n’est pas le seul à regretter cette profonde disparité. Patrick Bertrand, directeur général de Cegid, l’un des trop rares éditeurs français à avoir dépassé les 200 millions d’euros (258 millions avec 2 000 salariés) fait le même constat. Et il se souvient du temps où une valorisation « normale » avait permis à Cegid de financer sa croissance sur le marché français. C’était en 1986 ! Ajoutez à cela un troisième facteur, d’importance, et vous comprendrez pourquoi Neolane et tant d’autres ont finalement choisi la voie du rachat. « Quand elles ont repéré une start-up qui les intéresse, les Américains n’hésitent pas à mettre une grande quantité d’argent sur la table pour s’en saisir », dit Stéphane Dehoche.
Que dit Stéphane Dehoche, ex-PDG et cofondateur de Neolane ? Tout d’abord, le premier handicap pour un éditeur français de logiciels, par rapport à un homologue américain, tient à la taille limitée du marché français et à la fragmentation du marché européen, ce qui freine sa croissance. Selon lui, si l’on prend deux entreprises équivalentes, l’une française, l’autre américaine, pour cette simple raison, « dans le même laps de temps, la première atteindra un chiffre d’affaires, par exemple, de 50 millions d’euros, quand la seconde plafonnera à 10 millions… » Deuxième handicap pour le français de l’étape : la valorisation en Bourse. La mise sur le marché est la voie royale pour favoriser le changement de dimension d’une start-up et financer sa croissance. Mais, note Stéphane Dehoche, « en France, la valorisation des entreprises de logiciels est très sous-estimée. Un facteur deux, voire trois, sépare la valorisation obtenue sur le Nasdaq de celle qu’une entreprise peut espérer en France ». Il n’est pas le seul à regretter cette profonde disparité. Patrick Bertrand, directeur général de Cegid, l’un des trop rares éditeurs français à avoir dépassé les 200 millions d’euros (258 millions avec 2 000 salariés) fait le même constat. Et il se souvient du temps où une valorisation « normale » avait permis à Cegid de financer sa croissance sur le marché français. C’était en 1986 ! Ajoutez à cela un troisième facteur, d’importance, et vous comprendrez pourquoi Neolane et tant d’autres ont finalement choisi la voie du rachat. « Quand elles ont repéré une start-up qui les intéresse, les Américains n’hésitent pas à mettre une grande quantité d’argent sur la table pour s’en saisir », dit Stéphane Dehoche.
Il sait de quoi il parle : Adobe a déboursé par moins de 600 millions de dollars (458 millions d’euros), en 2013, pour acquérir Neolane, dont le chiffre d’affaires était inférieur à 50 millions d’euros ! C’est typiquement « An offer you can’t refuse »… Quel acteur européen se permettrait ce luxe ? Y en a-t-il même un ?
Peu de candidats français au rachat
Cela met d’ailleurs en lumière le rôle fondamental de l’écosystème « numérique » d’un pays. Après tout s’il y a tant de Français rachetés par des Américains, c’est tout simplement parce qu’en matière de numérique, il y a abondance d’entreprises américaines de taille respectable, donc susceptibles de réaliser des acquisitions – et cela dans tous les secteurs du logiciel. C’est presque une lapalissade ! C’est, à coup sûr, un cercle vicieux. Face à cela, le manque de « champions français » est criant. Les candidats au rachat se comptent sur les doigts d’une main. Orange, par exemple, peut endosser ce rôle. C’est ainsi que, bon gré mal gré, il a joué les sauveurs vis-à-vis de pépites nationales comme Deezer ou Dailymotion. Qui d’autre ? A coup sûr, Dassault Systèmes. Comme toute grande entreprise, il a une masse suffisante pour absorber, tel un trou noir, toute start-up qui passe à sa portée et, ce faisant, assurer son développement. Il ne s’en  prive pas. Pour nourrir sa croissance, il en a acquis près d’une vingtaine sur la dernière décennie. Beaucoup sont américaines, mais parmi les rachats figurent aussi nombre de start-up ou ex-start-up françaises. Exemple : Virtools (réalité virtuelle) en 2005 ; Exalead( moteur de recherche, big data) en 2010 ; Elsys (CAO électronique) en 2011 ; Netvibes (Web social) en 2012 et Archividéo (modélisation urbaine) en 2013. Mais, évidemment, ces deux entreprises ne peuvent, à elles seules, prendre en charge toutes les entreprises en quête d’acheteurs… et il n’y a pas beaucoup d’autres acteurs majeurs pour remplir cette fonction. Bonne nouvelle toutefois, Criteo, riche de son introduction en Bourse, pourrait jouer ce rôle. Après avoir acquis l’anglais AD-X Tracking, il vient ainsi de racheter la start-up française Tedemis et on peut espérer qu’il ne s’arrêtera pas en si bon chemin… Parmi les freins qui empêchent les start-up du numérique de devenir vraiment grandes figurent évidemment les grands classiques, qui impactent toutes les entreprises : la fiscalité, les charges, l’ absence d’un vrai marché unique européen, etc. Inutile de développer. Patrick Bertrand insiste sur un autre point : « Il n’y a toujours pas en France suffisamment de soutien de la commande publique, alors qu’elle représente une part importante du marché. » Il ajoute : « Les grands groupes, de leur côté, ne font pas suffisamment confiance aux jeunes pousses et, souvent, ne jouent pas le jeu, même si la situation a évolué, notamment avec le Pacte PME. » Un point de vue partagé par Miguel Valdes Faura, même si le patron et cofondateur de la jeune start-up Bonitasoft, l’exprime autrement : « Nous n’avons jamais autant vendu aux entreprises du CAC 40 que depuis que nous avons fait la preuve de notre réussite auprès de grands comptes américains… »
prive pas. Pour nourrir sa croissance, il en a acquis près d’une vingtaine sur la dernière décennie. Beaucoup sont américaines, mais parmi les rachats figurent aussi nombre de start-up ou ex-start-up françaises. Exemple : Virtools (réalité virtuelle) en 2005 ; Exalead( moteur de recherche, big data) en 2010 ; Elsys (CAO électronique) en 2011 ; Netvibes (Web social) en 2012 et Archividéo (modélisation urbaine) en 2013. Mais, évidemment, ces deux entreprises ne peuvent, à elles seules, prendre en charge toutes les entreprises en quête d’acheteurs… et il n’y a pas beaucoup d’autres acteurs majeurs pour remplir cette fonction. Bonne nouvelle toutefois, Criteo, riche de son introduction en Bourse, pourrait jouer ce rôle. Après avoir acquis l’anglais AD-X Tracking, il vient ainsi de racheter la start-up française Tedemis et on peut espérer qu’il ne s’arrêtera pas en si bon chemin… Parmi les freins qui empêchent les start-up du numérique de devenir vraiment grandes figurent évidemment les grands classiques, qui impactent toutes les entreprises : la fiscalité, les charges, l’ absence d’un vrai marché unique européen, etc. Inutile de développer. Patrick Bertrand insiste sur un autre point : « Il n’y a toujours pas en France suffisamment de soutien de la commande publique, alors qu’elle représente une part importante du marché. » Il ajoute : « Les grands groupes, de leur côté, ne font pas suffisamment confiance aux jeunes pousses et, souvent, ne jouent pas le jeu, même si la situation a évolué, notamment avec le Pacte PME. » Un point de vue partagé par Miguel Valdes Faura, même si le patron et cofondateur de la jeune start-up Bonitasoft, l’exprime autrement : « Nous n’avons jamais autant vendu aux entreprises du CAC 40 que depuis que nous avons fait la preuve de notre réussite auprès de grands comptes américains… »
Les Etats-Unis… planche de salut
L’engagement des grandes entreprises, pourtant, peut être déterminant. Ce fut le cas pour Cegid, qui a bénéficié du soutien de groupes comme Lacoste ou L’Occitane pour le développement du volet international de son activité retail. « Ce sont eux qui nous ont demandé de les accompagner sur des grands marchés comme les Etats-Unis ou l’Asie-Océanie. Grâce à cela, l’export représente désormais près d’un tiers de cette activité, soit 15 millions d’euros sur 46 millions », rappelle Patrick Bertrand. Les freins à la croissance ne manquent donc pas.
Y a-t-il, à l’inverse, des accélérateurs de développement ? Clairement, en matière de numérique, il y en a un de toute première magnitude et c’est… l’implantation aux Etats-Unis. Pas l’ouverture d’une simple agence commerciale. Une vraie implantation avec armes et bagages. Tout le monde ou presque vous le dira. Et d’abord Axway (1 700 personnes, 224 millions d’euros de chiffre d’affaires), qui apparaît aujourd’hui tout aussi américain aux locaux, que français aux yeux des Français. Son siège opérationnel est installé à Phoenix (Arizona) et c’est là que réside son directeur général, Christophe Fabre, tandis que les exécutifs  (souvent américains) sont répartis entre Phoenix et le siège du groupe à Puteaux (Hauts-de- Seine). Pourquoi se poser aux Etats-Unis ? « Pour la capacité à lever des fonds, la taille du marché, la capacité à mieux valoriser les technologies et le fait que les Américains privilégient l’achat de produits d’entreprises locales », résume Christophe Fabre. Mais, pour lui, la principale raison reste malgré tout celle-ci : « Qu’on le veuille ou non, les technologies numériques naissent aux Etats-Unis. Il faut y être présent pour détecter au plus tôt les signaux faibles et réagir très vite. Si l’on attend que les technologies arrivent en Europe, il est déjà beaucoup trop tard. Les entreprises américaines ont déjà affûté leurs produits sur leur marché. » Cette rapide américanisation, première étape d’une indispensable internationalisation, apparaît désormais comme une évidence et donne des ailes à la nouvelle génération de start-up françaises. Criteo illustre parfaitement cette démarche. Il l’a même menée jusqu’à son terme ultime. Immédiatement après avoir fait la preuve de son produit sur le marché français, soit à la mi-2009, Jean-Baptiste Rudelle, président et cofondateur, s’est installé avec sa famille – et son entreprise – dans la Silicon Valley. Il ne s’est pas arrêté là. Il a également eu recours à des investisseurs locaux (5 millions d’euros de Bessemer Venture Partners en 2010) et a fini, en 2013, par faire coter, avec succès, Criteo sur le Nasdaq. Le Nasdaq ? Stéphane Dehoche nous a fait comprendre pourquoi. Quant au reste, Jean-Baptiste Rudelle explique : « Il est indispensable pour le responsable de l’entreprise d’être sur place, ne serait-ce que pour recruter les meilleurs talents, ce qui est très difficile aux Etats-Unis. » Quant au financement par les entreprises locales, il souligne : « Le capital-risque, ce n’est pas seulement de l’argent. C’est surtout la possibilité de disposer localement d’un solide réseau. Ce qui fait la différence. » Cette pratique en matière de financement avait d’ailleurs déjà été la sienne pour se déployer en Europe, puis pour s’attaquer à l’Asie en 2012, en s’appuyant cette fois sur le japonais SoftBank. Criteo, qui a annoncé un chiffre d’affaires de 114 millions d’euros au troisième trimestre 2013, est désormais présent dans trente-sept pays avec des bureaux dans quinze d’entre eux. Mais, toutefois, l’essentiel de la R&D reste en France : « La France dispose d’informaticiens, de mathématiciens de très haut niveau. Cela constitue un réel avantage concurrentiel », précise Jean-Baptiste Rudelle.
(souvent américains) sont répartis entre Phoenix et le siège du groupe à Puteaux (Hauts-de- Seine). Pourquoi se poser aux Etats-Unis ? « Pour la capacité à lever des fonds, la taille du marché, la capacité à mieux valoriser les technologies et le fait que les Américains privilégient l’achat de produits d’entreprises locales », résume Christophe Fabre. Mais, pour lui, la principale raison reste malgré tout celle-ci : « Qu’on le veuille ou non, les technologies numériques naissent aux Etats-Unis. Il faut y être présent pour détecter au plus tôt les signaux faibles et réagir très vite. Si l’on attend que les technologies arrivent en Europe, il est déjà beaucoup trop tard. Les entreprises américaines ont déjà affûté leurs produits sur leur marché. » Cette rapide américanisation, première étape d’une indispensable internationalisation, apparaît désormais comme une évidence et donne des ailes à la nouvelle génération de start-up françaises. Criteo illustre parfaitement cette démarche. Il l’a même menée jusqu’à son terme ultime. Immédiatement après avoir fait la preuve de son produit sur le marché français, soit à la mi-2009, Jean-Baptiste Rudelle, président et cofondateur, s’est installé avec sa famille – et son entreprise – dans la Silicon Valley. Il ne s’est pas arrêté là. Il a également eu recours à des investisseurs locaux (5 millions d’euros de Bessemer Venture Partners en 2010) et a fini, en 2013, par faire coter, avec succès, Criteo sur le Nasdaq. Le Nasdaq ? Stéphane Dehoche nous a fait comprendre pourquoi. Quant au reste, Jean-Baptiste Rudelle explique : « Il est indispensable pour le responsable de l’entreprise d’être sur place, ne serait-ce que pour recruter les meilleurs talents, ce qui est très difficile aux Etats-Unis. » Quant au financement par les entreprises locales, il souligne : « Le capital-risque, ce n’est pas seulement de l’argent. C’est surtout la possibilité de disposer localement d’un solide réseau. Ce qui fait la différence. » Cette pratique en matière de financement avait d’ailleurs déjà été la sienne pour se déployer en Europe, puis pour s’attaquer à l’Asie en 2012, en s’appuyant cette fois sur le japonais SoftBank. Criteo, qui a annoncé un chiffre d’affaires de 114 millions d’euros au troisième trimestre 2013, est désormais présent dans trente-sept pays avec des bureaux dans quinze d’entre eux. Mais, toutefois, l’essentiel de la R&D reste en France : « La France dispose d’informaticiens, de mathématiciens de très haut niveau. Cela constitue un réel avantage concurrentiel », précise Jean-Baptiste Rudelle.
Les patrons français s’impliquent
La démarche de Criteo, inaugurée en France par Business Objects dès 1990 (y compris la cotation au Nasdaq), est celle que les start-up israéliennes pratiquent de longue date. Elle est désormais loin d’être isolée. Pour ne citer que deux exemples, Talend et Bonitasoft, éditeurs de logiciels open source (intégration de données pour l’un, pour l’autre, businessprocess management) ont joué la même carte : implantation précoce aux Etats-Unis, dépaysement de leur patron et R&D maintenue en France. Toutes deux sont intéressantes pour une autre raison. Elles révèlent une évolution significative et prometteuse : une maturation de l’écosystème français numérique qui se manifeste par les liens que tissent les responsables  des start-up françaises. Forts de leur succès, les « pionniers » interviennent pour faciliter la tâche des nouveaux venus. Ainsi, Bernard Liautaud, l’un des deux fondateurs de Business Objects, aujourd’hui General Partner du capital-risqueur Balderton, a non seulement participé au financement de Talend lors de sa création, en 2006, mais est aussi entré au board de l’entreprise. C’est, aujourd’hui, au tour de Bertrand Diard, cofondateur de Talend, de soutenir Bonitasoft, créé en 2009, en participant à son conseil d’administration. La réussite des uns favorise celle des autres et fait boule de neige. Ce phénomène s’accompagne en outre du développement du financement par le capital-risque français et, enfin, de dotations conséquentes, indispensables ne seraitce que pour financer le coûteux développement aux Etats-Unis. Bonitasoft a ainsi réussi à lever pas moins de 22,5 millions d’euros au total auprès d’entreprises hexagonales. Les deux premiers tours de table, qui lui ont respectivement apporté 4,5, puis 8 millions d’euros, venaient de Ventech, Auriga Partners et Serena Capital. Et c’est enfin la jeune Bpifrance qui a apporté 10 millions d’euros lors du récent et troisième round de financement. Quant à Talend, il vient, lors d’un nouveau tour de table en décembre, de lever 40 millions de dollars (29 millions d’euros) auprès, principalement, de Bpifrance et Iris Capital.
des start-up françaises. Forts de leur succès, les « pionniers » interviennent pour faciliter la tâche des nouveaux venus. Ainsi, Bernard Liautaud, l’un des deux fondateurs de Business Objects, aujourd’hui General Partner du capital-risqueur Balderton, a non seulement participé au financement de Talend lors de sa création, en 2006, mais est aussi entré au board de l’entreprise. C’est, aujourd’hui, au tour de Bertrand Diard, cofondateur de Talend, de soutenir Bonitasoft, créé en 2009, en participant à son conseil d’administration. La réussite des uns favorise celle des autres et fait boule de neige. Ce phénomène s’accompagne en outre du développement du financement par le capital-risque français et, enfin, de dotations conséquentes, indispensables ne seraitce que pour financer le coûteux développement aux Etats-Unis. Bonitasoft a ainsi réussi à lever pas moins de 22,5 millions d’euros au total auprès d’entreprises hexagonales. Les deux premiers tours de table, qui lui ont respectivement apporté 4,5, puis 8 millions d’euros, venaient de Ventech, Auriga Partners et Serena Capital. Et c’est enfin la jeune Bpifrance qui a apporté 10 millions d’euros lors du récent et troisième round de financement. Quant à Talend, il vient, lors d’un nouveau tour de table en décembre, de lever 40 millions de dollars (29 millions d’euros) auprès, principalement, de Bpifrance et Iris Capital.
Ne pas manquer d’ambition dès le départ
Ces belles aventures, parmi beaucoup d’autres, lèveront- elles la malédiction qui semble avoir frappé la génération précédente. Peut-on espérer qu’à l’ère d’Internet, il finira par émerger quelques (vraiment) grandes entreprises du numérique ? Un conseil en tout cas à ceux qui veulent se lancer. C’est Jean-Baptiste Rudelle qui le donne : « Les conditions du succès se résument à deux points clés : il faut évidemment disposer d’un très bon produit, innovant et à très forte valeur ajoutée, mais il est tout aussi  important de voir grand dès le départ. » Ce type d’ambition est, pour le patron de Criteo, ce qui fait défaut à beaucoup d’entrepreneurs français et restreint la croissance de leurs entreprises. « Voir grand », n’est en effet pas qu’une simple formule. C’est la condition pour architecturer, dès le début, l’entreprise de façon à ce qu’elle puisse supporter sans broncher une croissance phénoménale. C’est ainsi que l’essentiel des start-up américaines a toujours pratiqué. C’est ce que Criteo, Talend ou Bonitasoft ont fait. Bon début.
important de voir grand dès le départ. » Ce type d’ambition est, pour le patron de Criteo, ce qui fait défaut à beaucoup d’entrepreneurs français et restreint la croissance de leurs entreprises. « Voir grand », n’est en effet pas qu’une simple formule. C’est la condition pour architecturer, dès le début, l’entreprise de façon à ce qu’elle puisse supporter sans broncher une croissance phénoménale. C’est ainsi que l’essentiel des start-up américaines a toujours pratiqué. C’est ce que Criteo, Talend ou Bonitasoft ont fait. Bon début.
Cet article fait suite à une série d’interviews publiées sur le site de La Fabrique de l’industrie (www.la-fabrique.fr).


 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique