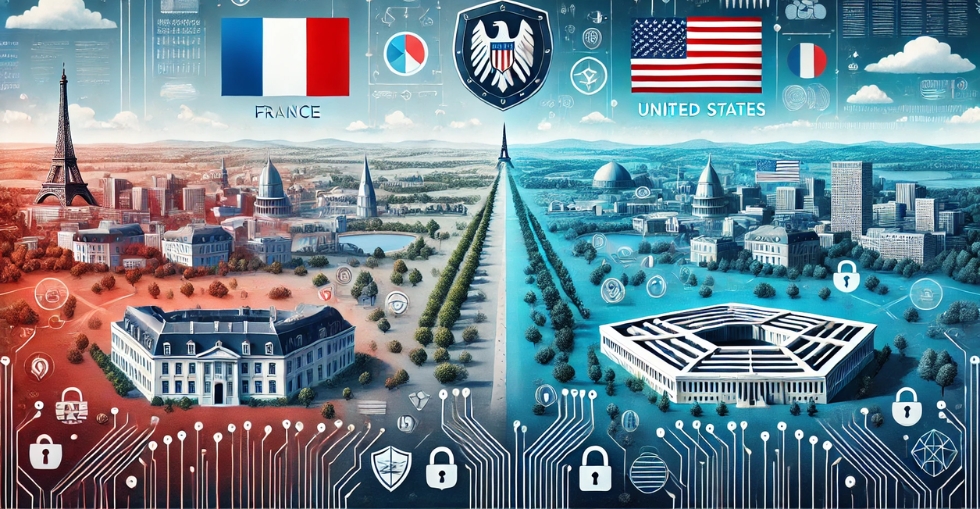La communauté Alliancy Connect s’est réunie fin juin pour échanger sur le thème de la construction des champions technologiques en France et en Europe. Entre analyses sur les enjeux de financement, de culture entrepreneuriale mais aussi sur la nature de ce qui fait la souveraineté numérique, les membres ont pu échanger avec des experts variés. Et réfléchir aux meilleurs leviers à activer demain.
« On ne parle jamais autant de souveraineté que quand on en manque ». Étienne Drouard n’y va pas par quatre chemins en introduction du débat Alliancy Connect consacré à la construction de champions technologiques. Avocat au sein du cabinet Hogan Lovells, et l’un des plus grands spécialistes des technologies de l’information et de la protection des données personnelles en Europe, il fait ainsi profiter l’assemblée d’un retour aux fondamentaux alors que bien trop souvent « chaque personne a sa propre définition de la souveraineté », ce qui entretient un flou artistique confortable pour parler de sujets épineux du numérique.
« La souveraineté ramène à l’exercice du pouvoir. C’est une très vieille définition, avec une racine latine, qui définit le résultat de la suprématie, c’est-à-dire d’un pouvoir qui supplante tous les autres. C’est en quelque sorte « le pouvoir d’imposer sa décision », cela implique donc une forme de conflictualité. Une société, une nation, organise déjà en son sein ce « pouvoir de pouvoir ». C’est la souveraineté interne, qui dans les démocraties passe par exemple par l’élection de représentants politiques ».
Entre la France et les Etats-Unis, deux définitions de la souveraineté
Mais par rapport aux enjeux internationaux du numérique, c’est souvent beaucoup plus de souveraineté externe dont il est question. Or, c’est là aussi au niveau des définitions que les troubles prennent leur source entre l’Europe et le reste du monde. « La France a défini en 1946 sa souveraineté externe comme étant l’établissement de rapports internationaux dans le but d’établir la paix et l’égalité, sous réserve de réciprocité », rappelle ainsi Étienne Drouard. « C’est très différent de la vision des superpuissances. Depuis 1974 par exemple, la souveraineté externe américaine est uniquement rattachée au vocabulaire de la sécurité nationale. Elle renvoie au fait d’utiliser des leviers militaires, sociaux, économiques pour être le plus fort dans une discussion. Pour la Chine, il s’agit également de neutraliser les menaces alternatives aux intérêts de la nation ».
Or, en matière de rapport de force, le numérique s’est progressivement imposé comme un élément fondamental. « On a souvent assimilé les grandes plateformes, portées par leur puissance économique mais aussi par la protection juridique de leur État, dans ce contexte, à un levier à part entière », souligne ainsi l’avocat. Avant d’ajouter : « Quand 92 % des données mondiales sont hébergées par des acteurs américains ou sur sol américain, il n’y a de facto pas besoin de revendiquer une souveraineté sur les données ».
Dans ce cadre, les acteurs européens, et la France en particulier, ont tendance à parler plus que leurs voisins de souveraineté. D’autant plus que l’Union européenne ne peut que difficilement se considérer comme une puissance souveraine, alors qu’aucun de ses États-membres ne lui délègue sa souveraineté nationale. « Demain, il y aura une souveraineté numérique européenne uniquement si l’on change le rapport global à la souveraineté, notamment avec une volonté populaire. Ce n’est donc pas prêt de se réaliser ! » insiste Étienne Drouard.
Se différencier à l’international, un sujet différent
Pour les grands acteurs français du numérique, la question ne se pose d’ailleurs pas toujours en ces termes. Ainsi, Caroline Comet-Fraigneau, vice-présidente d’OVHcloud pour la France, le Benelux et l’Afrique, a détaillé l’expérience de son entreprise dans sa croissance internationale : « Pour toucher un marché comme les États-Unis, on ne peut pas se retrancher derrière la souveraineté et c’est exactement pour cela que l’on ne veut pas être réduit à une étiquette de « cloud souverain ». Cela consisterait à être défensif alors que nous voulons attirer parce que le produit est bon et parce que nous avons des différences, des innovations à faire valoir, vis-à-vis de nos compétiteurs ». Elle estime d’ailleurs que les entreprises technologiques doivent partir à l’international très tôt, même si cela leur demandera souvent d’importantes phases de réorganisation pour soutenir la croissance. Ainsi que des choix stratégiques : « En Asie-Pacifique par exemple, nous avons fait le choix assumé de ne pas nous positionner sur les activités business to business, et de nous concentrer sur les offres digitales en business to consumers », illustre-t-elle.
Une analyse partagée par Catherine Nohra-China, à travers sa longue expérience d’analyste IT et en tant qu’entrepreneuse. « Les acteurs qui veulent se présenter comme des alternatives et qui espèrent devenir des champions, ne se posent souvent pas assez la question du « comment créer de la valeur de différenciation réelle ? ». Beaucoup trop de start-up ont tendance à simplement copier des idées existantes et à ne pas chercher à changer en profondeur les modèles d’affaires ». La spécialiste estime au contraire qu’il est possible de gagner des appels à projets contre des plus grands et plus puissants, en « ne répondant pas au même niveau et en adoptant un angle différent sur la proposition de valeur ». Et de souligner qu’aux États-Unis également, des petites entreprises tech doivent se réinventer dans leurs concurrences face aux géants.
Lier quotidien opérationnel et préoccupations stratégiques et géopolitiques
Face aux enjeux géopolitiques, c’est donc également le sujet de la culture des dirigeants d’entreprise qui est revenu dans les discussions. Pour Patrice Schoch, enseignant-chercheur en sciences de gestion, spécialisé en intelligence économique et stratégique, et sur les sujets d’innovation et d’entrepreneuriat, le constat est assez sévère. « Les entreprises ont du mal à faire le lien entre des préoccupations géopolitiques, stratégiques et complexes, et leur quotidien opérationnel », décrit-il. Autrement dit, prises par des décisions sur le fonctionnement de leurs activités, les dirigeants ne sortent pas la tête du guidon pour penser l’impact de sujets comme la souveraineté sur le futur de leurs activités.
« Ce n’est d’ailleurs pas aidé par le fait que la discipline d’intelligence économique est souvent perçue comme de l’espionnage, et donc de mauvaise réputation, plutôt que comme une nécessité en termes de veille, de protection informationnelle, d’influence… », souligne le chercheur. Il relève que les « études stratégiques » sont de moins en moins en grâce chez les entrepreneurs. Et cela risque de continuer : « Les étudiants s’intéressent de moins en moins au SWOT ou au PESTEL (des cadres d’analyse de stratégie d’entreprise, NDLR), et quand ils le font, c’est pour les remplir « au doigt mouillé » sans méthodologie sérieuse. Or comment peut-on avoir des visions de long terme pour la tech, quand on ne se concentre que sur le court terme ? ».
Et l’enseignant de conclure : « Il est plus que jamais important de s’intéresser à la géopolitique aujourd’hui, mais cela demande du temps. Et la sphère politique ne donne pas le bon exemple, en ayant des visions parfois simplistes comme « il nous faut plus de licornes ». Or, grandir à l’international, créer des champions, c’est un enjeu de chaîne de valeur globale, qui ne s’arrête pas aux frontières de l’entreprise. Derrière, ce sont des territoires à amener dans la transformation, de nouveaux partenaires à associer, de nouveaux risques à anticiper… »