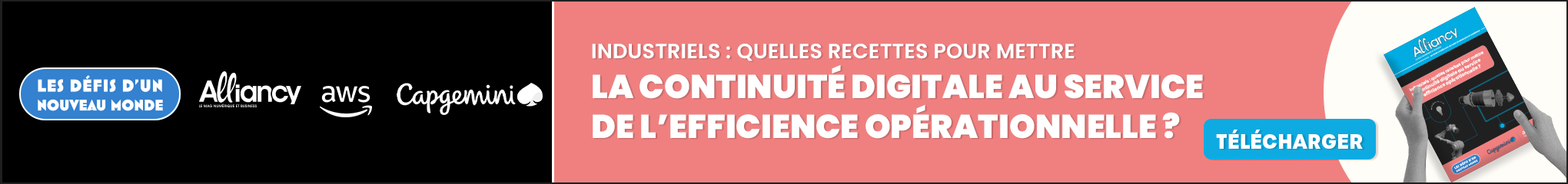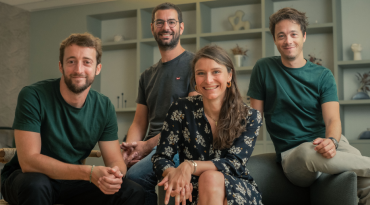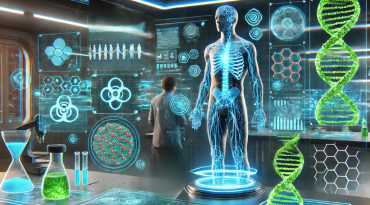[Série Futurs Numériques 1/4] À chaque innovation numérique majeure, est désormais associée dans l’imaginaire collectif les risques que son usage faire peser sur la vie démocratique ou les libertés individuelles. Selon Virginie Tournay, directrice de recherche au CNRS, cette méfiance vis-à-vis du numérique est cependant avant tout lié à une perte de confiance dans les pouvoirs publics.
Alliancy. Au début des années 2000, le numérique inspirait positivement. Aujourd’hui, son futur est souvent présenté par le prisme de la dystopie. Selon vous, pourquoi y a-t-il eu ce changement de regard ?
Virginie Tournay. Je ne pense pas que notre manière d’appréhender le futur du numérique ait radicalement changé depuis le tournant du siècle, je pense plutôt que nous ne mettions pas les mêmes réalités concrètes sous le terme de numérique. Faut-il rappeler qu’au début des années 2000, les réseaux sociaux n’existaient pas et que nous n’avions aucune dépendance vis-à-vis des objets « connectés ». Les grands mythes structurants qui accompagnent le développement des outils technologiques sont arrivés au moment où notre quotidien a commencé à être bouleversé par la puissance de ces outils de calcul et de communication. D’ailleurs, le mythe étant de nature ambivalente, à côté de la dystopie, on voit que le numérique est aussi associé à la « perfectibilité indéfinie de l’esprit humain » pour reprendre la formule de Condorcet. Le transhumanisme en fait même une planche de salut.
Quels aspects du numérique jouent le plus dans le fait que les peuples soient souvent pessimistes sur son futur ?
Je pense que la dérégulation du marché de l’information associée à la numérisation de nos sociétés, entraînant avec elle de façon mécanique, une certaine confusion entre ce qui relève des faits et ce qui relève des croyances, ne joue pas de façon positive sur un plan collectif. Cela favorise la montée en puissance des théories complotistes. Aussi, cette “dé-hiérarchisation” des échelles de vérité retentit nécessairement sur la manière de se penser en tant que société et sur notre avenir collectif.
Selon vous, y a-t-il un gap générationnel au sujet du numérique ?
Je pense qu’il faut effectivement distinguer la génération Z regroupant les individus nés après 1997, des générations précédentes, car les formes de socialisation, l’apprentissage et le rapport à la réalité informationnelle sont vécus de manières très différentes dans un environnement marqué par l’essor des communications numériques. Les outils de captation de l’attention n’ont rien à voir. Leur liberté de pensée et de se mouvoir ne peut pas s’envisager indépendamment de ses outils, ce qui n’a rien à voir avec la perception que peut en avoir la génération d’après-guerre. On peut penser que la génération alpha, faisant référence aux individus nés après 2010, sera encore plus encline à penser son expression intime et sociale à travers les médiations numériques.
Cette défiance vient-t-elle d’un manque de confiance dans les entreprises, dans les technologies de sécurité ou en la capacité des états à réguler ?
À vrai dire, je suis plus inquiète de la défiance grandissante que l’on observe vis-à-vis des institutions régaliennes que dans les outils numériques. Les États peuvent avoir des difficultés à réguler, mais la confiance est davantage reliée à la capacité de nos institutions à savoir établir un lien de proximité avec ses usagers. C’est le monopole de l’Etat dans les domaines régaliens qui est questionné, mis à l’épreuve par le fait que de plus en plus de citoyens rentrent dans les logiques de captation des géants du numérique qui proposent des services « massivement personnalisés ». Ils apparaissent comme des alternatives plus satisfaisantes que certains instruments proposés par les institutions publiques. Je pense à la fonction safety check de Facebook qui offre un service de sécurité intérieure. Ça marche parce que l’on se sent davantage proche de Facebook que du gouvernement. Le fait que bon nombre d’entre nous critique les géants du numérique ne veut pas dire que l’on ne s’approprie pas les outils qu’ils proposent ! Représentation sociale et appropriation technologique ne se superposent pas forcément.
Comment imaginez-vous que sera l’image du numérique dans les décennies à venir ?
C’est une question difficile. Pour moi, l’image du numérique est indissociable de la confiance que nous aurons ou pas dans les institutions républicaines. Pouvoir anticiper la matérialité, les formes concrètes que prendront les algorithmes dédiés aux services publics est une nécessité. On ne confie pas nos mêmes données à l’Etat et à Uber. Dans un cas, on est client, dans l’autre, on est usager du service public.
Comment pensez-vous qu’il serait possible de redonner de la confiance, être optimiste au sujet du numérique ?
C’est au niveau du « guichet administratif » que se jouent les représentations associées à la puissance publique et à l’intérêt général « la street level bureaucracy ». Il faudra voir comment les terminaisons de l’action publique seront touchées par l’ubérisation de l’État. Le modèle organisationnel de la plateforme basé sur un contact direct avec les usagers reconfigure radicalement notre rapport aux données administratives, lesquelles ne sont plus localisées sur le territoire des institutions publiques.

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique