L’association des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) organise le 3 avril la 2ème édition de la « Journée nationale de l’ingénieur » dans plus de 28 villes françaises. Julien Roitman, président de l’IESF, à l’origine de cette initiative, revient sur l’importance de valoriser l’image du métier d’ingénieur.

Julien Roitman, Président de l’IESF
Alliancy, le mag. Fin 2013, vous avez réformé les statuts d’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France). C’était indispensable ?
Julien Roitman. J’ai pris la présidence de l’association il y a quatre ans. A l’époque, elle était dénommée « Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France » ou CNISF. Cette structure comptait parmi ses membres aussi bien des associations que des personnes physiques… Il fallait dépoussiérer les statuts et retrouver une certaine homogénéité entre tous ces acteurs. Deux ans ont été nécessaires pour y aboutir. Nous sommes désormais une « fédération » qui regroupe 180 associations d’ingénieurs et de diplômés scientifiques en France.
Ce sont toutes des associations d’écoles d’ingénieurs ?
Nos membres se répartissent en trois grandes familles. Les associations de diplômés et d’anciens élèves, issus majoritairement des écoles d’ingénieurs, au nombre de 130, et parmi lesquelles commencent à apparaître des structures issues de l’université ; les unions régionales (25), qui sont des entités juridiques autonomes et notre relais sur tout le territoire ; et enfin, une trentaine d’associations scientifiques, techniques et professionnelles (comme la Société française de Physique ou Les Ingénieurs diplômés de l’Etat…). Avec cette organisation, le caractère fédéral d’IESF est réaffirmé.
C’est-à-dire ?
Nous ne faisons pas de lobbying, ni de politique au sens politicien du terme. Nous sommes un groupe d’influence qui représente la profession en France face aux pouvoirs publics, au monde économique (Medef, CGPME, patronat, CESE…), à celui de l’enseignement supérieur (écoles et universités). Notre valeur ajoutée consiste à apporter notre analyse dans les grands débats publics, sur des sujets aussi divers que l’environnement, le transport, l’énergie, l’agroalimentaire… Nous rappelons les faits et les chiffres de base et tentons de poser aux politiques les quelques questions qui dérangent.
Vous avez quelques exemples à citer ?
Nous sommes intervenus dans les débats sur les gaz de schiste, sur le nucléaire suite à l’accident de Fukushima ou encore sur le statut des étudiants étrangers en France… Autre exemple avec la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche. Nous avons milité pour que les entreprises soient représentées dans les nouveaux conseils d’administration des universités. Nous avons également exprimé notre regret quant à la suppression de l’AERES en charge de l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en alertant notamment le gouvernement sur le risque qu’il y avait à créer un nouvel organisme qui laisserait trop de latitude à l’auto-évaluation.
Et ça a marché ?
Oui, partiellement. Dans le texte de loi aujourd’hui, il y a deux chefs d’entreprise dans chacun de ces conseils ! Par contre, nous n’avons pas eu gain de cause sur l’AERES, qui va disparaître au profit d’un Haut-Conseil de l’évaluation de l’Enseignement supérieur…
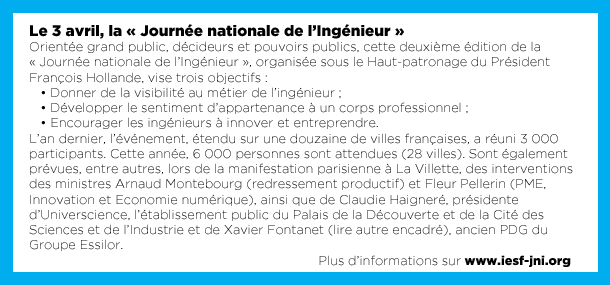
Parmi vos autres actions, IESF a lancé avec l’Académie des Technologies, l’Apec et le Cefi (Comité d’études sur les formations d’ingénieurs), la « Fabrique des vocations scientifiques et techniques ». De quoi s’agit-il exactement ?
Cela fait près de deux ans que nous avons initié ce projet ambitieux, pour lequel nous n’avons obtenu l’approbation et les financements qu’en novembre dernier. Retenu au titre du programme CSTI (culture scientifique, technique et industrielle) du Programme d’Investissements d’Avenir, ce projet bénéficiera d’une aide d’un million d’euros sur trois ans (budget total : 2 millions), qui devra être progressivement relayée par des apports externes.
Cette initiative vise à améliorer l’attractivité des études et des métiers scientifiques en les rendant plus lisibles. Elle entend aider tant les étudiants que les professionnels dans leurs choix de carrière et s’adresse en priorité aux prescripteurs, c’est-à-dire aux enseignants du secondaire et de l’enseignement supérieur. Notre démarche va du docteur (bac+8) au technicien supérieur (bac+2) et contribuera peut-être à réduire la vraie fracture qui existe en France entre le technicien et l’ingénieur. Ce sont chez nous deux mondes distincts, alors qu’en Allemagne, c’est un même cursus, continu et progressif.
Comment fonctionnera la Fabrique ?
La Fabrique conduira à la production de synthèses transversales marché-emploi-formation, rassemblant sur un mode critique les acquis disponibles sur une quinzaine de filières stratégiques que sont l’aéronautique, l’agroalimentaire, les éco-industries, la santé… complétées par une explicitation des grands défis technologiques et industriels à relever dans les prochaines années et leur traduction en déploiement dans les régions françaises. Nous allons commencer par la filière aéronautique en Midi-Pyrénées, région où se situent les plus grandes usines d’Airbus et de ses sous-traitants.
Par ailleurs, depuis l’an dernier, vous plaidez pour la création d’un « Ordre » des Ingénieurs afin de réglementer la profession et, à terme, l’ouvrir à tous les parcours. Quel est votre objectif ?
En France, le titre d’ingénieur n’est pas protégé. Seul le diplôme l’est, depuis 1934. Deux cents écoles publiques, privées ou universitaires sont aujourd’hui accréditées par la Commission des titres d’ingénieur (CTI), pour le délivrer. Nous sommes le seul pays au monde avec un tel système. Pour autant, comment protéger le public ? Comment vérifier les compétences ? Comment maintenir le niveau tout au long d’une carrière ? Selon nos estimations, 200 000 à 300 000 professionnels exerceraient le métier d’ingénieur en France sans en avoir le diplôme… Il faudra bien un jour réglementer ce titre et les conditions d’exercice de la profession via une structure, « Ordre » ou autre.
Est-ce complexe à mettre en place ?
Les points de vue sont variés et le débat est parfois houleux ! Il faut convaincre à la fois la classe politique et la profession. Mais il y a déjà consensus sur la nécessité d’une structure professionnelle reconnue comme interlocuteur légal par les Pouvoirs publics, et d’une action rapide pour s’y diriger. Nous avons lancé en octobre dernier un groupe de travail dont j’ai confié le pilotage au polytechnicien François Lureau. D’ici à la fin 2014, une quinzaine de personnalités issues des écoles, des associations dans toute leur diversité, de la CTI et d’autres institutions… doivent définir les missions de ce futur organisme.
Vous en êtes où ?
Un projet de structure est en cours, que l’on soumettra à toute la profession, car un large consensus est souhaitable. Des études comparatives vont aussi être menées, avec les autres pays (Espagne, Italie, Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada…), mais aussi en France avec d’autres professions. Enfin, la question juridique doit être posée car, quel que soit l’aboutissement du projet, il passera par un processus législatif. D’ailleurs, dès que possible, nous comptons ouvrir un blog pour que chacun puisse s’exprimer et faire part de ses idées. Il faut que nous arrivions à créer un sentiment d’appartenance fort à une profession et plus seulement à une école…
C’est ce vous appelez le « syndrome du village gaulois » ?
Tout à fait. En Allemagne ou en Italie, on se revendique d’entrée de jeu « ingénieur VDI ou membre de l’Ordre »… Chez nous, si vous posez la question, l’ingénieur vous répondra : « J’ai fait Centrale, Supélec, Mines… » L’école prime ! Nous avons donc 200 villages qui doivent s’unir. C’est ce sentiment d’appartenance à un corps professionnel qu’IESF cherche à développer. C’est en train de venir, mais cela va de pair avec cette structure que nous avons évoquée.
Il y a donc urgence à le faire…
Vous avez des décisions qui se prennent concernant le pays. Or, dans le tour de table des décideurs, très peu ont un background scientifique ou technique… alors qu’un minimum de ce type de culture est indispensable quel que soit le sujet. C’est un vrai problème quand on sait que les ingénieurs représentent 4 % de la population active en France… Pour rappel, les trois-quarts des hauts dirigeants chinois sont ingénieurs, et Mme Merkel elle-même est docteur en physique. Si on arrive à obtenir plus de présence d’ingénieurs dans la vie publique au sens large, ce sera bon pour tout le monde. Mais, pour y parvenir, il faut les pousser à le faire. Ce n’est pas dans leur ADN.
Un calendrier a-t-il été arrêté ?
J’espère arriver à un consensus au sein de la profession fin 2014. Nous porterons ensuite le projet d’IESF au niveau gouvernemental et parlementaire dans le courant du 1er semestre 2015. Nous devrions pouvoir obtenir l’accord sur une structure opérationnelle début 2017.
Pensez-vous, comme certaines autres associations, qu’il manque d’ingénieurs en France ?
Non, il n’y a pas de pénurie. Sur les 35 000 ingénieurs qui sortent diplômés chaque année, 20 % partent travailler à l’international. Pour ceux qui restent, l’offre et la demande sont à peu près équilibrées. Même si, ici ou là, il peut y avoir des tensions… Et encore ! Cela varie énormément. Les secteurs de l’informatique et du numérique sont actuellement en manque, mais il faut savoir de quoi on parle : ingénieurs, codeurs, techniciens ? D’autres semblent en excès de diplômés comme la chimie et la biologie…
Ce qui veut dire qu’on pourrait en former davantage ?
Oui… à condition de savoir ce qu’on en ferait. À mon sens, la France pourrait probablement absorber 10 000 à 15 000 ingénieurs de plus par an, en espérant que l’économie reparte…
Qui pourrait absorber un tel surplus ?
Les PME-PMI par exemple ! Encore trop peu d’ingénieurs partent travailler dans les petites entreprises. C’est un constat que fait aussi la CGPME. C’est à la fois historique et culturel. Pourtant, les PME-PMI qui ont « goûté » de l’ingénieur, en veulent encore… Notamment après les avoir rencontrés grâce aux pôles de compétitivité qui raisonnent en mode « projets collaboratifs ».
Voyez-vous d’autres voies ?
La France doit se choisir trois ou quatre grands domaines d’activité dans lesquels elle déciderait de s’engager à fond sur les vingt-cinq ans qui viennent… Il faut se concentrer, investir, attirer les entreprises étrangères et ajuster les formations indispensables. Le numérique pourrait être un axe de développement, même s’il est un peu trop large, la robotique aussi…
Que pensez-vous d’intéresser les ingénieurs à l’entrepreneuriat ?
C’est évidemment oui ! A condition que « PME » ne veuille pas forcément dire « start-up ». C’est une chose que nous répétons avec beaucoup de constance : il faut travailler autant sur les reprises que sur les créations d’entreprises. A IESF, nous pensons que les ingénieurs seraient tout à fait pertinents sur ce premier point. Ils aiment le concret, quitte à tout remettre à plat, revoir les organisations, les machines… Il y a d’ailleurs un climat qui s’installe en ce sens. Lors de notre enquête annuelle, il y a deux ans, nous leur avions demandé s’ils avaient un projet personnel d’entrepreneuriat en tête : 11 % en moyenne avaient répondu « OUI ». Ce chiffre montait à 25 % pour les moins de 30 ans.
C’est très positif…
Tout à fait. De même, au sein des associations d’anciens élèves, on voit de plus en plus apparaître des groupes d’entrepreneurs ou de Business Angels… C’est un signe qui ne trompe pas. La création, fin 2012, du réseau des Business Angels des Grandes Ecoles (Badge) est également un indice.
Et les incubateurs internes aux écoles d’ingénieurs, c’est aussi une solution ?
C’est un troisième indice ! Le plus flamboyant étant celui de l’ESPCI ParisTech qui dépend de la Ville de Paris et où ont officié Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak… Cet incubateur infuse l’esprit d’entreprenariat à ses étudiants depuis de très nombreuses années. On peut citer aussi l’incubateur ParisTech Entrepreneurs, opéré par Télécom ParisTech, qui remet chaque année les prix Tremplin Entreprises au Sénat… ou encore, celui de Centrale Paris. Tout ceci se développe et il faut l’encourager.
Vous diriez la même chose pour l’apprentissage ?
C’est un vrai plus. 12 000 élèves seraient actuellement en formation par apprentissage dans les écoles d’ingénieurs. Ce sont des diplômés de BTS ou de DUT que l’on amène à un diplôme d’ingénieur. Ces jeunes suivent à la fois une formation scolaire et une alternance dans une entreprise. Leur stage, ils le font en général dans une PME ou PMI, avec à la sortie, une proposition d’embauche… Cette politique des grandes écoles a eu comme effet induit de réhabiliter l’apprentissage et l’image des apprentis en France.
Actuellement, on parle beaucoup de numérique. Pensez-vous que les ingénieurs soient suffisamment au fait sur ce sujet ?
De même qu’il faut savoir lire, écrire et compter, ou encore parler anglais et se servir d’un ordinateur, un ingénieur doit connaître le numérique. Cela fait et fera de plus en plus partie de sa formation de base, même si le mot est un peu tarte à la crème. D’ailleurs, il n’y a pas une seule école d’ingénieurs qui ne fasse pas quelque chose sur le sujet… Avec le temps, on remontera sans doute plus vers le niveau de la théorie et sur la partie la plus conceptuelle du numérique. Il y a déjà des formations qui se développent en ce sens.
Sur le million d’ingénieurs français, près de 15 % travaillent à l’international. Quels liens entretenez-vous avec eux ?
Bien trop peu, même si nous nous battons pour les mobiliser… Ce sont des professionnels compétents installés dans des pays dont ils connaissent la culture locale et les réseaux. Alors qu’on cherche à promouvoir l’image et les produits français à l’international, l’Etat pourrait agglomérer ces forces en réseau, par le biais de ses représentations économiques ou technologiques à l’étranger, grâce à un travail commun entre le Quai d’Orsay et le Ministère du Redressement productif. Dans leur conquête de nouveaux marchés, les entreprises françaises pourraient faire appel à eux… Ce n’est pas encore le cas. Pourtant, en tant qu’ingénieurs, nous avons un rôle évident à jouer dans le redressement de la France.
C’est pourquoi vous avez choisi, pour cette 2ème édition de la « Journée Nationale de l’Ingénieur », le thème « Innover, Entreprendre » ?
L’ingénieur est innovateur par nature. Il a tout pour devenir entrepreneur dès qu’il y a une technologie à la clé. Aujourd’hui, 96 % des ingénieurs français sont encore salariés, les 4 % restants sont à leur compte. Au nombre d’environ 40 000, ceux-ci œuvrent dans le conseil, l’audit ou dirigent la boîte qu’ils ont créée… En travaillant bien, nous devrions pouvoir doubler la mise à 8 % d’ici à 2020. C’est cet engagement que nous essayons d’insuffler fortement à notre public d’ingénieurs, partout en France.
Qu’est-ce que l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) ?
La France compte plus d’un million d’ingénieurs et de scientifiques. Organe représentatif de la profession reconnu d’utilité publique depuis 1860, Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est organisé en fédération. Il rassemble une large majorité de ces ingénieurs et scientifiques à travers 180 associations de diplômés, scientifiques, techniques ou professionnelles, réseau d’unions régionales et sections internationales.
Plus d’informations sur www.iesf.fr
