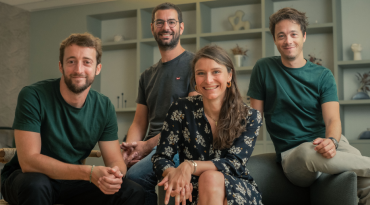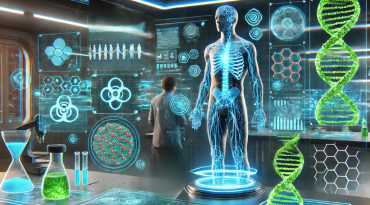Pour le dossier consacré à l’humain et au « care » dans le monde du travail, Alliancy s’est entretenu avec le sociologue spécialiste de ces enjeux Jean-Yves Boulin, chercheur associé à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso) de l’Université Paris-Dauphine. L’occasion de revenir sur les différentes pistes envisagées pour améliorer le bien-être de ses salariés et imaginer la place accordée à la technologie dans le futur du travail.

Jean-Yves Boulin, chercheur associé à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso) de l’Université Paris-Dauphine.
Alliancy. Il y a trois ans vous vous inquiétiez de l’extension du travail dominical. Cette tendance est-elle toujours d’actualité ? Se serait-elle accentuée ?
Jean-Yves Boulin. La pandémie a obligé nombre de commerces à fermer. La sortie des différents confinements s’est traduite par un relâchement s’agissant du respect de la réglementation sur le travail dominical. Aujourd’hui on constate en effet une généralisation des ouvertures dominicales et en nocturne y compris dans des zones non touristiques.
À lire aussi : Le « care », vraie transformation ou opération de communication ?
Avec Laurent Lesnard (Observation Social du Changement à Sciences Po) nous avions documenté l’impact que le travail dominical a sur la vie familiale, sociale et de loisirs des salariés qui travaillent ce jour-là alors que les lois Maillé (2009) et Macron (2015) invoquaient les changements de modes de consommation, la concurrence touristique avec les autres villes européennes et le potentiel de création d’emplois. Sur ce dernier point et sur celui de l’impact sur la vie des salariés, la loi Macron prévoyait qu’un observatoire soit mis en place. Six années plus tard, ni Observatoire, ni le moindre bilan pour voir si la prophétie des « milliers d’emplois créés » s’était réalisée !!
La semaine de quatre jours pourrait-elle être une mesure pertinente pour améliorer la qualité de vie des collaborateurs ?
Jean-Yves Boulin. La semaine de quatre jours qui a fait l’objet d’un certain engouement en France durant les années 1990 à la suite des propositions de Pierre Larrouturou, connaît aujourd’hui un regain d’intérêt, stimulé par la crise sanitaire qui a induit des modifications dans les représentations du travail et de ses rythmes. Au niveau international, elle est déjà relativement généralisée en Islande et est expérimentée en Nouvelle Zélande, au Royaume-Uni, au Japon et fait l’objet d’un projet de loi en Californie.
En France, plusieurs entreprises, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, l’ont mise en place en 2021. Selon les premières évaluations, cette organisation du temps de travail coche positivement les cases sociale (meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle), économique (hausse de la productivité, baisse de l’absentéisme) et environnementale (moins de déplacements, modification des comportements de consommation qui privilégient l’auto-production, le faire soi-même).
Mais pour produire tous ces effets positifs il convient que la semaine de quatre jours soit assortie d’une baisse du temps de travail : le plus souvent la norme des 8h quotidiennes demeure ce qui conduit à une durée de 32h, mais dans certains cas la durée hebdomadaire est de 28h. L’introduction de la semaine de quatre jours en maintenant une durée hebdomadaire de 40h (rappelons qu’en France la durée moyenne effective du temps de travail d’un salarié à temps plein dépasse 39h) ne paraît pas soutenable dans le temps car tous les effets positifs tendent à être annulés : la fatigue dûe à l’augmentation de la durée quotidienne induit des usages du temps moins favorables à des modifications de comportements de mobilités et de consommation, tandis que l’augmentation du temps de travail quotidien se traduit par des rendements décroissants et une augmentation des accidents du travail.
Vous êtes donc plutôt favorable à la réduction du temps de travail ?
Jean-Yves Boulin. En leur temps, John Maynard Keynes ou Bertrand Russell imaginaient une semaine de 15 heures de travail tandis que Jean Fourastié estimait que l’on travaillerait 40 000h sur l’ensemble d’une vie. Si je cite ce dernier c’est pour indiquer que les modalités de réduction du temps de travail peuvent être diverses. On peut agir sur la durée quotidienne comme cela a été expérimenté à Göteborg en Suède au cours de cette décennie avec l’introduction de la journée de six heures dans des établissements de santé ou chez un concessionnaire Toyota.
Mais cela avait déjà été initié en Finlande avec l’idée que l’on pouvait découpler le temps de travail des personnes et les horaires de fonctionnement des organisations productives ou non : ainsi les services pouvaient être accessibles douze heures par jour en faisant se succéder deux équipes travaillant chacune six heures par jour. Cette logique du découplage entre temps des hommes et des machines avait d’ailleurs fait l’objet d’un rapport remis par Dominique Taddéi, alors député, au premier ministre Laurent Fabius au milieu de la décennie 1980. Un tel découplage, cette fois-ci sur la semaine avait été mis en œuvre avec les équipes VSD (Vendredi, Samedi, Dimanche) qui permettaient dans certaines industries un fonctionnement 7 jours sur 7 (4 jours pour certains et 3 jours pour les VSD).
Mais la réduction du temps de travail peut aussi prendre la forme d’une réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine (semaine de 4 jours par exemple), ou encore du nombre de jours ou semaines travaillés dans l’année (augmentation des congés), voire à travers l’introduction de pauses durant la vie professionnelle. Cela dépend des contextes et des secteurs d’activité : certains secteurs nécessitent de fonctionner de façon continue ce qui tend à privilégier des réductions quotidiennes ou hebdomadaires ; d’autres ont une activité saisonnière qui amène à réfléchir à des modalités annuelles etc.
En tout état de cause, de mon point de vue de sociologue du travail je suis en faveur d’une réduction collective du temps de travail : certains pays, notamment du nord de l’Europe ont favorisé des réductions individuelles, c’est-à-dire le temps partiel (aux Pays-Bas, la moitié de la population en emploi travaille à temps partiel !!), qui est un facteur d’inégalité, particulièrement entre les hommes et les femmes.
Est-ce que ces mesures passeront nécessairement par des luttes sociales ? Les entreprises sont-elles globalement impliquées de manière sincère dans cette avancée ?
Jean-Yves Boulin. Le problème en France est que le taux de syndicalisation est très faible par rapport à d’autres pays comparables en termes de développement : la France se retrouve dans le peloton de queue avec les pays d’Europe centrale. De plus, les syndicats en France sont nombreux et divisés, ce qui entraîne des formes de concurrence entre eux préjudiciable au portage de revendications convergentes. Ainsi, la CFDT a beaucoup milité en faveur des 35h de façon un peu isolée à la fin des années 1990, tandis qu’aujourd’hui la CGT revendique les 32h, elle aussi de façon isolée.
En France, comme dans la plupart des autres pays européens ce sont les luttes sociales qui sont à l’origine du mouvement séculaire de réduction du temps de travail. Mais cette tendance est aujourd’hui stoppée, les 35h mises à part, et qui d’ailleurs depuis 2002 font l’objet d’un détricotage systématique conduisant à un allongement de la durée effective du travail sans que cela entraîne des mouvements sociaux importants. Ainsi, une loi de 2019 oblige les collectivités locales à imposer à leurs agents une durée du travail de 1607h par an, c’est-à-dire à supprimer de façon unilatérale et sans compensation des jours de congés qui avaient été octroyés aux agents en raison d’une impossibilité de les rémunérer comme dans le privé à qualification égale.
Si cette loi entraîne des mouvements sociaux au plan local, aucune confédération syndicale ne revendique une négociation nationale sur ce sujet. A la différence d’un pays comme l’Allemagne ou les pays nordiques, la culture de la négociation collective est assez peu répandue dans notre pays et n’est pas incitée par les différents gouvernements qui préfèrent la voie législative. Enfin, le patronat français est fortement opposé à toute forme de réduction du temps de travail à partir d’une argumentation qui fleure bon le XIXème siècle !! Les quelques entreprises qui innovent en ce domaine, celles dont nous avons parlé qui mettent en place la semaine de 4 jours, le font en général à l’initiative d’un patron éclairé et plus rarement à l’issue d’une lutte sociale.
La technologie peut-elle contribuer à plus de bien-être au travail ?
Jean-Yves Boulin. La technologie est évidemment une partie intégrante du bien-être au travail et plus généralement du futur du travail. La période que nous venons de connaître en atteste : la diffusion massive du télétravail dans un pays qui se montrait très timide à son égard avant la pandémie – toujours cette difficulté à déployer un vrai dialogue social – a été plutôt bien appréciée par les salariés, surtout à partir du moment où les enfants ont pu retourner à l’école. Mais, les recherches de terrain que j’ai pu faire montrent que l’appétence pour le télétravail est très corrélée à la durée du trajet domicile-travail, aux conditions de logement, à la situation familiale. Comme dans le cas du travail dominical il existe une tendance, afin de promouvoir le télétravail, à mettre en avant des arguments positifs dont la pertinence et les fondements sont assez faibles.
Les entretiens que j’ai conduits auprès d’une soixantaine d’agents d’une collectivité territoriale révèlent que le télétravail tel qu’il a été pratiqué durant la pandémie, c’est-à-dire sans préparation ni négociation, en situation d’urgence donc, a généré de nombreux effets négatifs dont il convient de tenir compte avant d’en généraliser l’usage. Il faut tenir compte de la nature du métier, des conditions de logement de la personne, de son équipement, de ses temps de transport, de sa situation familiale mais également de la dimension psychique de son activité. D’une façon générale les agents de cette collectivité ne souhaitent pas que le télétravail excède 2 jours par semaine, voire moins. Surtout ils revendiquent une souplesse dans son application, c’est-à-dire des possibilités de modulation de son usage en fonction des contextes familiaux, sociaux ou de mobilité.
À lire aussi : [Diaporama] 25 idées pour se sentir mieux !
Si la disparition du triptyque métro/auto-boulot-dodo est bien vécue par ceux dont le temps de transport dépasse entre 30mn et 1h par jour, la disparition de la séquence mobilité lorsqu’elle a une durée raisonnable est souvent regrettée car elle constitue une transition temporelle qui par exemple permet de déconnecter du travail avant de raccrocher les wagons de la vie familiale. Plusieurs études montrent que le télétravail a entraîné une augmentation du temps de travail quotidien : 10% selon une étude américaine, 48mn par jour selon deux autres études. La question de la déconnexion est ici centrale et doit faire l’objet d’une régulation.
Par ailleurs le télétravail génère des inégalités, d’abord de genre et cela a été largement documenté par de nombreux articles, mais aussi sociaux entre les catégories qui peuvent télétravailler, parfois en se délocalisant dans des environnements idylliques, et celles qui ne le peuvent pas. Le clivage cols blancs/cols bleus est ici pertinent et ses conséquences méritent d’être pensées et faire l’objet de négociations. Enfin, le télétravail accentue la tendance à l’œuvre depuis plusieurs décennies d’un brouillage des frontières entre la vie professionnelle et la vie familiale ce qui selon moi conduit à en réfléchir les modalités d’exercice afin de trouver des alternatives au travail depuis le domicile. Les tiers lieux, si ils sont bien pensés, en lien avec le territoire, constituent une alternative au travail au domicile tout à fait pertinente.
Est-ce important, comme dans les pays nordiques, de prendre en compte la dimension du temps de travail à l’échelle d’une vie ?
Jean-Yves Boulin. C’est un de mes axes de recherches, que je partage avec d’autres chercheurs européens. Je faisais allusion au début de notre entretien aux 40 000 heures de Jean Fourastié. De fait, aujourd’hui en raison du changement technologique permanent auquel nous sommes confrontés, nous savons que nous n’exercerons pas le même métier tout au long d’une carrière. Il faut donc prévoir des périodes assez longues pour se recycler, changer de métier. La transition écologique et le changement technologiques induisent des pertes d’emplois dans certains secteurs et des créations d’emplois dans d’autres.
Pour éviter des catastrophes sociales comme celles que nous avons connues avec la sidérurgie il faudra que les salariés qui exercent dans les secteurs concernés par les fermetures puissent faire autre chose. Un vrai programme de formations longues sera nécessaire. De même, dans de nombreux secteurs d’activité, les conditions de travail sont telles que le travail n’est pas soutenable sur le long terme. Environ un tiers des travailleurs européens âgés entre 35 et 55 ans estiment qu’ils ne pourront pas exercer leur travail jusqu’à l’âge de la retraite.
Par ailleurs, dans une vie de travail, il y a une période très tendue, celle entre, en gros, 30 et 45/50 ans où l’on doit conduire une carrière professionnelle, une activité parentale à laquelle se substitue une activité de soutien aux parents : ce que l’on appelle le travail du care, qui dépasse dans mon esprit la sphère purement familiale pour également concerner la société tout entière. Le débat français sur le report de l’âge de la retraite est sidérant de ce point de vue, d’une pauvreté intellectuelle confondante. De fait, ce débat est régi par ce que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres.
Pourquoi la possibilité de travailler plus longtemps en âge (c’est la bonne nouvelle !) doit elle se traduire par travailler un plus grand nombre d’années ? Pourquoi seul le travail rémunéré serait-il positif pour la société ? Dans les années 1970, un économiste Suédois, Gösta Rehn avait imaginé que l’on puisse entrecouper une vie de travail par des coupures destinées soit à se former, soit à s’occuper de ses enfants (cela a donné le congé parental), soit pour s’engager dans une action civique ou humanitaire, soit pour tout simplement faire une coupure loisir. Il appelait cela la société du « libre choix » et pensait à juste titre que durant les périodes de crise économique il fallait actionner ces leviers plutôt que de faire basculer les individus dans le chômage.
Récemment le Ministère Allemand du travail a confié à une équipe de chercheurs le soin de réfléchir à une nouvelle organisation de la vie au travail en introduisant la possibilité donnée aux salariés de disposer jusqu’à neuf années pour ces différentes activités.
Vous vous opposiez il y a quelques années au slogan de Nicolas Sarkozy : « travailler plus pour gagner plus ». Aujourd’hui, la culture entrepreneuriale liée à la French Tech cultive de plus en plus cette idée que le startupper ne compte plus ses heures… Qu’en pensez-vous ?
Jean-Yves Boulin. Je pense que cette idéologie – car c’en est une – est le creuset des inégalités qui ne cessent d’augmenter dans notre pays. Au 19ème, ainsi que l’a théorisé Thorstein Veblen, le must de l’élite était de ne rien faire, ou plutôt de s’adonner aux loisirs. Aujourd’hui c’est de travailler de longues heures (sans que l’on sache si la productivité est vraiment au rendez-vous) pour accumuler beaucoup d’argent.
Résultat nous avons une société dans laquelle ceux qui ont les codes (acquisition des compétences, des savoir être, pouvoir d’imposer) prospèrent tandis que la grande masse est rejetée dans la pauvreté y compris en travaillant de longues heures : lorsque vous êtes livreur chez Deliveroo ou conducteur chez Uber, vous devez travailler de longues heures pour gagner votre vie. Ce n’est pas travailler beaucoup qui est un problème en soi mais le fait que ces longues heures de travail soient imposées, comme c’est le cas pour des jeunes diplômés qui entrent dans une start-up ou un cabinet d’audit, ou pour des cols bleus qui doivent accumuler les heures supplémentaires pour boucler la fin du mois.
Un artiste peut travailler de longues heures et y prendre plaisir parce qu’il choisit son activité, parce qu’il s’y réalise, tout comme un chercheur comme moi peut passer de longues heures de travail à rédiger un ouvrage ou écrire un article. Mais personne ne m’y oblige. Ce qui est posé par cette problématique c’est la question du choix, qui doit être régulé de façon collective par la négociation.
De ce point de vue, il faut qu’il y ait des contre-pouvoirs dans l’entreprise sur lesquels les choix des salariés puissent s’adosser : ces contre-pouvoirs ce sont les syndicats, des formes de représentation des salariés qui viennent équilibrer le pouvoir des actionnaires, comme par exemple le bicamérisme prôné par Isabelle Ferraras et d’autres et la présence à parité avec celle des représentants des actionnaires, des représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises comme en Allemagne. Sans cela, le « travailler plus pour gagner plus » n’est qu’un slogan qui traduit une posture idéologique.

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique