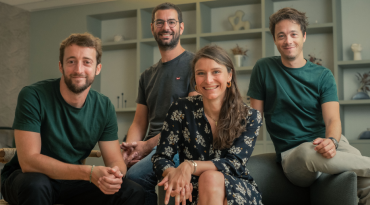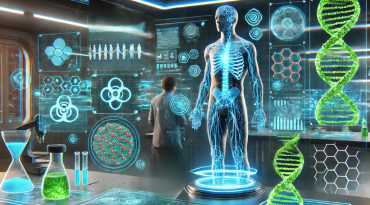[Chronique de François-Xavier Petit] Le télétravail est-il seulement du travail à distance ? Et sinon, de quoi nous prive-t-il vraiment ? De Karl Marx à Paul Ricoeur, voyage au cœur d’un épineux concept.

Car dans la crise, au-delà de l’actualité sanitaire dont nous sommes majoritairement spectateurs, il se joue quelque chose dont nous sommes les acteurs : nous tous face à la question du travail. En professionnels, nous avons pris le parti de maintenir autant que possible l’activité en réorganisant nos entreprises, services, équipes en télétravail. Tous, nous jonglons avec les visio, les salles de travail virtuelles, les applis, etc. Mais, d’un coup, sans crier gare, une question nous a sauté au visage : qu’est-ce que travailler, au juste ?
En pure étymologie, le télétravail suppose de travailler « à distance ». La différence serait donc seulement géographique ? Absolument pas ! Et tous ceux qui font l’expérience du travail au milieu des enfants ou seul chez soi, pris dans la fin de la séparation domicile / travail (déjà bien affaiblie) et dans les visioconférences (réfugié dans la chambre de sa fille sous le poster de la reine des neiges) mesurent l’écart avec le travail. Ajoutons l’absence des collègues, parfois l’activité partielle… Discrètement s’est insinuée une forme de trouble ou d’inconfort dans le rapport au travail. Pourquoi ? Et si… ? Ne pourrais-je pas… ? Les questionnements surgissent, se répètent. Ainsi affleure le sentiment étrange d’être à la fois à l’étroit et lâché dans la nature, encombré et vide. Est-ce seulement l’effet des conditions matérielles ? Ou, au contraire, le trouble s’est-il glissé dans le concept même de travail ? Je crois que c’est ce second cas.
A lire aussi : [Chronique] Télétravail et chômage partiel, vers un « télé-burnout » ?
Alors retournons dans la séculaire réflexion sur le travail.
Marx et le travail comme clé de voûte de nos sociétés
Ce stade, on ne pouvait pas faire sans Marx. Dans l’introduction générale à la critique de l’économie politique de 1857, Marx fait une percée en posant le travail comme une catégorie générale venant unifier toutes les formes d’activités, au motif que la société bourgeoise, en généralisant les échanges, a fait de toute chose une marchandise – là où les corporations médiévales comme les statuts nobiliaires sortaient de la sphère économique bon nombre d’activités. C’est fondamental, car en posant le travail comme catégorie unifiée et objet d’échange économique, il devient LA catégorie centrale. Et que l’on soit marxiste ou non, nous restons dans cette structuration. Car le travail est au centre. Au centre de nos occupations si l’on fait le compte des heures travaillées dans notre vie, au centre de la politique tant l’engagement de lutte contre le chômage est répété, au centre de la protection sociale puisqu’elle est le fruit des cotisations du travail (salariales comme patronales), au centre de l’identité des gens qui se définissent par leur travail, au centre de la vie des entreprises dont les collaborateurs restent le premier actif. Bref, ce que Marx voit demeure : le travail est la clé de voûte de nos sociétés.
> A lire aussi : Télétravail : et si on apprenait à travailler plus efficacement ?
Et c’est bien cela que le confinement vient percuter. D’abord parce que le télétravail nous a demandé de sélectionner nos activités. Sous des dehors anodins, c’est vertigineux car ce tri vient disloquer l’unité marxienne du concept de travail. D’un coup, l’inactivité forcée – qui était jusqu’alors l’ennemi intime appelé chômage – devient admise et impérative ! En parallèle, s’opère un grand tri entre les activités essentielles ou non, possibles ou non, selon un autre ordre des valeurs que le critère marchand. Et toutes les situations deviennent admissibles : travailler ou non, de chez soi ou non, en devenant essentiel (les derniers de cordée sont devenus les premiers, aide-soignante, caissière et éboueur en tête) ou en ne l’étant plus du tout. Tant et si bien que l’éparpillement des formes du travail devient prédominant, fracturant l’unité de la catégorie travail. Et cela même à niveau micro, puisque chacun s’organise comme il veut / peut. Au fond, c’est comme si nous étions revenus dans un cadre d’avant l’économie politique telle qu’analysée par Marx.
Et en Grèce ancienne, alors ?
Avant l’économie politique (à situer à partir du XVIIIe siècle), à quoi cela nous renvoie-t-il ? A la Grèce ancienne, par exemple. C’est désormais l’immense historien Jean-Pierre Vernant qui va nous guider. Il nous enseigne que le concept unifié de travail n’existe pas en Grèce (Mythe et pensée chez les Grecs, 1965). Au contraire, l’activité est éparpillée en une myriade de figures, toutes désignées par un terme différent. Ainsi, l’activité des champs n’est pas considérée comme de même nature que le fait de faire commerce. Quand le ponos désigne l’activité pénible, l’ergon est le produit de sa propre vertu, tandis que la techne concerne la fabrication. On pourrait multiplier les termes tel l’oikos se limitant au travail domestique, ou suivre Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, qui distingue chaque forme du travail agricole comme une activité à part. Une chose est sûre : l’unité du travail est absente… tandis que la nôtre éclate… Sans doute la catégorie travail se réunifiera-t-elle passé le confinement, mais pendant que nous le vivons, nous faisons l’expérience de la dislocation globale autant qu’intime, quand son propre travail – rythmé d’habitude par les échanges, les contacts, les environnements – se disloque lui aussi. Bien sûr, on fait face. Mais manager à distance n’est pas vraiment manager, produire à distance ne l’est pas complètement, pas plus qu’arbitrer, délibérer, assembler, présenter ses travaux, etc.
D’ailleurs, cette dislocation du concept a des répercussions dans le monde pratique. Consciemment ou non, plus encore que jamais, nous coordonnons, veillons à transmettre l’information, à faire se parler des gens qui ne se voient plus au quotidien, bref à maintenir ensemble les morceaux de nos collectifs et de nos activités. Oui, en un sens, travailler, c’est lutter contre le désordre. Cette définition, c’est Michel Serres qui nous la souffle : « Si nous laissons faire sans intervenir, les écuries s’encombrent de fumier, le renard vient manger les poules, le phylloxera traverse les mers pour assécher les feuilles du sarment » Le parasite, (1980). Aussi, nous ne laissons pas faire – tout entravés que nous sommes – et tentons cette mise en ordre (appelée « plan de continuité de l’activité ») contre le désordre (appelé incapacité à délivrer à son client, perte de chiffre d’affaire, oisiveté des collaborateurs…). Donc, oui, très clairement, le confinement vient aiguiser les enjeux qui traversent le travail.
Cette parole qui nous manque…

Ce que Marx voit demeure : le travail est la clé de voûte de nos sociétés.
Tirons le fil du désordre. L’expression de Michel Serres a son importance, car plutôt que désordre, il emploie le mot « bruit », au sens de brouhaha. Et ce faisant, il nous ouvre une perspective. Car quel silence dans ce télétravail ! Je ne parle pas du chahut des enfants, ni du bruit de fond que sont les blagues des collègues sur Slack, mais bien de l’absence de la parole de l’autre, du sentiment d’être seul, même si on est des millions à être seuls. Voilà peut-être pourquoi le travail s’échappe en ce moment. Parce que la parole n’est plus là. La parole dans sa version incarnée, c’est à dire qui mobilise aussi le corps de l’autre et tout ce que le non-verbal dit (un sourire capté en réunion, une mine déconfite après un arbitrage perdu…). C’est cette parole dense, physique, qui nous manque, et que le flot verbal déversé dans les zoom et les Skype ne parvient pas à compenser. Paul Ricœur, dans un texte de 1953 va plus loin dans l’analyse de cette parole et de son caractère constitutif du travail. Certes, à première vue, c’est l’outil qui est l’instrument par excellence du travail, pas le langage. Mais l’outil est trop proche du corps pour être l’instigateur du changement. En témoigne la résistance au changement de l’outil artisanal ou paysan (cf le métier à tisser des canuts).
C’est la parole qui bouleverse la forme acquise par le geste et l’outil. Le langage anticipe, signifie, opère les transformations dans l’imaginaire. Et si la praxis s’annexe la parole (décrire le geste, le transmettre), en retour, la parole vient théoriser le geste et donc dépasser cette praxis. Elle naît avec le travail mais suspend aussitôt sa reproduction, car elle réfléchit. Et pour Ricœur, il n’y a en fait que du co-labeur et du travail parlé, donc un aller-retour permanent entre le geste et le langage, entre ma voix et la voix des autres, entre mon corps et le corps des autres, guidés par nos voix. En langage courant, ce jeu des voix et des corps s’appelle réunion, briefing, rendez-vous, formation… Le travail n’est qu’un perpétuel jeu des voix et des corps…. tout l’inverse de ce qui se passe derrière l’écran noir de GoogleMeet, caméra coupée pour économiser de la bande passante, où l’interlocuteur n’est que voix (et parfois bruit) coupée de son corps, ou alors un corps dégradé dans une petite vignette hachée par le flux vidéo pas toujours stable.
La réduction de la petite lucarne de l’ordinateur
Donc le télétravail vide en partie le travail de sa corporéité. Et dans le corps absent, c’est la relation qui se dissipe, ou se réduit. Après l’éclatement de la catégorie travail, après le flot verbal qui n’est pas la parole, voilà la disparition du corps. Car, enfin, pourquoi travaille-t-on ? On pourrait répondre que c’est vital, le moyen de gagner son pain, donc sa vie. Oui, sans doute. Mais c’est finalement peu de chose par rapport à l’explication véritable de notre engagement dans le travail. On travaille par besoin du collectif, parce que le travail permet à une société de mettre en question sa propre existence en cherchant à résoudre des problèmes. Ou, pour le dire comme le philosophe Georges Simondon (Du mode d’existence des objets techniques), ce qui compte, c’est « devenir ». Devenir soi. Ceci passe par l’action, la mise en jeu du corps, voire de sa vie pour les métiers dangereux, dans une relation à l’autre et au milieu, dans une manière de s’employer face aux problèmes qui trament notre relation au monde. Voilà pourquoi on travaille et pourquoi, la petite lucarne de l’ordinateur en situation de confinement, réduit notre capacité corporelle à se mouvoir dans la relation au monde. Donc en bloquant le corps, en le rivant à nos appartements, on bloque une partie du travail ; en désincarnant la relation de travail, on laisse la plus grande part s’échapper malgré nous. C’est précisément ce que le télétravail (en mode full) éclipse.
Mais il y a peut-être plus encore pour expliquer l’inconfort de notre moment « Covid-19 ». En effet, plus précisément que le corps, le travail, c’est le contact. André Leroi-Gourhan (archéologue et grand penseur de la technique) a bien montré qu’il y dans presque tous les actes techniques, la recherche du contact, du toucher (Evolutions et Techniques, II). Comment prendre contact ? Comment prendre en main son milieu ? L’expérience du travail est donc celle de l’extension du mouvement. Alors, confinés chez nous, nous voilà bien à rebours du travail ! Dans l’absence de contact ou dans la réduction du mouvement à l’absolue nécessité (et avec autorisation de sortie), notre travail – pourtant procédant du contact – s’en trouve privé. Voilà pourquoi le télétravail porte en lui bien des éléments qui font vaciller notre rapport au travail.
Alors, que l’on se comprenne bien, il ne s’agit pas de jeter la pierre au télétravail – qui permet quand même à bien des entreprises d’exister encore – mais plutôt de mettre des mots sur notre impression d’inconfort actuel. C’est bien une tempête silencieuse dans le concept de travail qui a lieu. Alors, positif ou négatif, le télétravail ? Il appartient à chacun de le dire, mais ne faisons pas semblant de croire qu’il s’agit juste du travail réalisé à distance. Plus que jamais, nous avons besoin de comprendre, de nous questionner, et des sciences humaines dans le contemporain.
Ce petit voyage dans le concept montre, je crois, l’ampleur de la déflagration.

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique