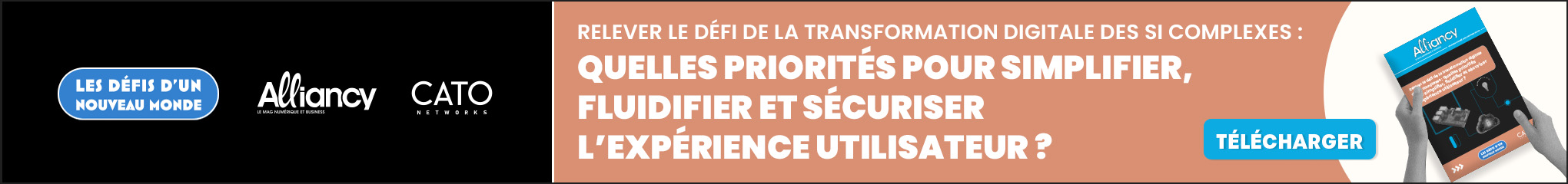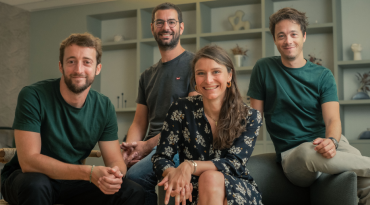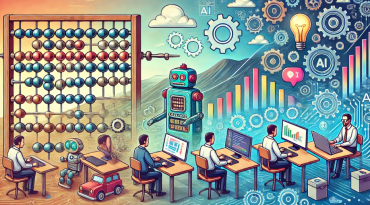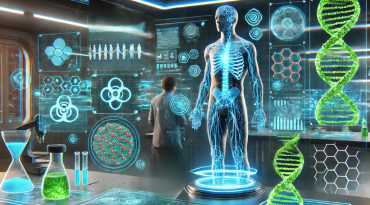Fin 2024, trente salariés MAIF tirés au sort ont formé une convention dédiée à l’intelligence artificielle générative pour explorer les conditions d’utilisation de l’IA par le groupe . Pascal Demurger, directeur général de l’assureur mutualiste revient aujourd’hui sur cette expérience innovante et sur les autres défis de l’accélération numérique auxquels il est confronté en tant que dirigeant.
MAIF a organisé il y a quelques mois une « Convention IA » pour ouvrir le débat avec ses collaborateurs sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans son organisation. Les participants étaient des collaborateurs tirés au sort dans toute l’entreprise. Quand et pourquoi cette décision a-t-elle été prise ?
Le moment de la sortie de ChatGPT fin 2022 a été un symbole extrêmement fort. Il a été vite évident que l’IA générative allait avoir un impact considérable dans notre monde de l’assurance et sur les modalités de travail quotidiennes de tous nos collaborateurs ou presque. J’ai vu à quel point ce moment a changé la perception de l’urgence chez tous mes confrères dirigeants, et comment il a considérablement accéléré les investissements en matière d’IA. Toutefois, dans le cas de la MAIF, nous venions alors tout juste de terminer la rédaction de notre nouveau plan stratégique pour le présenter à l’entreprise en janvier 2023… Il nous était impossible de tout mélanger. Nous avons donc décidé de laisser l’organisation absorber les messages et changements du plan, avant de nous concentrer sur l’IA générative. Fin 2023, nous avons donc décidé qu’il était temps de lancer les réflexions sur la Convention. En effet, il nous paraissait complètement légitime d’associer les collaborateurs aux conditions de déploiement et aux modalités d’emploi de l’IA dans l’entreprise, vu l’impact que celle-ci a sur le travail. Je ne voulais surtout pas que le déploiement de l’IA se fasse sans le corps social ou, pire, contre lui. On doit une transparence aux salariés face à ces changements et le consensus est nécessaire pour ne pas bloquer de telles transformations.
Une convention participative ne crée-t-elle pas un risque de déception ou de frustration quand l’entreprise ne change ensuite pas suffisamment vite selon les résultats ?
Nous avions tous à l’esprit l’engouement puis la déception qu’avait pu créer, par exemple, une grande convention participative comme celle organisée par l’État sur le climat. Il fallait donc fixer dès le départ des règles claires pour éviter de faire des surpromesses ou de trahir des attentes. J’ai donc introduit la première réunion sur le sujet en étant le plus factuel possible : « Vous, les conventionnels, allez être formés à l’IA puis réfléchir pendant quatre jours aux conditions de déploiement et aux cas typiques. En retour, l’engagement que prend la direction générale est d’étudier ce que vous allez proposer et de vous répondre sur chaque point ». En ce sens, j’ai indiqué que je ne prenais pas l’engagement de mettre toutes les propositions en œuvre, ni tout de suite. Je ne veux pas faire porter la responsabilité stratégique des décisions aux salariés, car c’est bien le rôle du dirigeant. Et le dirigeant doit être également au rendez-vous d’un autre sujet important : dès la première réunion, j’ai ainsi pris l’engagement qu’il n’y aurait aucune suppression d’emploi du fait de l’intégration de l’IA.
La convention et ses résultats ont-ils été à la hauteur de ce que vous attendiez ?
Je dirais que cela s’est sans doute même passé un peu mieux que ce que l’on imaginait au démarrage. Avec le recul, je vois trois points qui ont été particulièrement positifs. D’abord, la rapidité à laquelle certains membres de la convention, très réfractaires à l’IA, sont ressortis apaisés ou convaincus. Quand on est tiré au sort pour devenir conventionnel, on peut se dire que l’on n’a pas de connaissances sur le sujet, pas beaucoup à apporter, pas de légitimité ou encore avoir beaucoup d’appréhension sur l’IA… On peut dépasser cette limite de l’exercice avec un vrai effort d’acculturation, en laissant du temps pour travailler et en installant une ambiance qui ne met pas la pression aux participants ou qui n’exagère pas les attentes que l’on aurait vis-à-vis d’eux.
Ensuite, ces salariés issus de tous les métiers de l’entreprise ont fait émerger une quarantaine de propositions très pertinentes en seulement quatre jours ! Il y a été question à la fois de conditions et de garde-fous de mise en œuvre, mais aussi de cas d’usages métiers. Avec l’objectif de respecter la culture d’entreprise de la MAIF, c’est très positif. Le dernier point qui a dépassé mes attentes, c’est que les trente conventionnels ont permis d’infuser beaucoup plus rapidement cette initiative dans un corps social de 10 000 salariés. Les partenaires sociaux ont également aidé de leur côté, et l’effet de capillarité a été très important. C’était d’ailleurs une autre problématique que je souhaitais anticiper : le positionnement de cette convention par rapport aux organisations syndicales. En effet, dans un système représentatif, ce sont elles qui portent les attentes des salariés… Il ne faut donc pas qu’elles se sentent mises de côté par une telle initiative. Les informer et les impliquer en amont a été clé, et de même les résultats ont été restitués en CSE autant qu’en conseil d’administration.
Une fois une telle convention effectuée, où portez-vous vos efforts ?
La plus grande difficulté reste le passage à l’échelle : la formation de tous les collaborateurs pour que les projets puissent être compris par tous et qu’il y ait une adhésion. Les projets d’IA, comme tous les projets de transformation numérique, doivent être pluridisciplinaires et permettre de faire tomber les silos. C’est pourquoi nous avons décidé que tous les salariés devaient aussi suivre un COOC (Corporate Online Open Course, NDLR) obligatoire d’ici la fin de l’année. Nous menons en parallèle un travail d’envergure auprès des 6 000 salariés directement en contact avec les sociétaires ; on les interroge pour qu’ils puissent contribuer sur ce qu’on pourrait améliorer dans le travail quotidien et la relation sociétaire. Plusieurs centaines de salariés vont ainsi s’investir dans des réunions dédiées. Dans le même ordre d’idée, nous avons de nombreux rendez-vous prévus dans l’année : pour les 1 000 managers du groupe, mais aussi des journées stratégiques, organisées deux ou trois fois par an, avec 300 collaborateurs de terrain et sans les managers. L’ensemble de la direction générale va échanger avec eux pendant deux jours et l’IA fait partie des sujets stratégiques que nous abordons avec eux. Nous allons bien entendu faire également le suivi de la convention : réunir chaque année les 30 conventionnels et actualiser leurs informations sur le déploiement de l’IA dans l’entreprise, tout en écoutant leurs préconisations. Enfin, l’an prochain nous allons entrer dans le nouvel exercice de rédaction du plan stratégique qui pourra intégrer en profondeur également les enseignements de ces travaux sur l’IA.
En tant que dirigeant, vous vous êtes démarqué en vous exprimant très tôt sur l’intérêt du numérique. Quels sont les moments clés qui ont forgé votre engagement sur ces sujets ?
Cela fait 16 ans que je dirige la MAIF et je me souviens qu’il y a quinze ans, en séminaire de direction, le sujet du digital était déjà central. Quelques épisodes nous ont fait beaucoup réfléchir. En 2012, l’arrivée des GAFAM dans le monde de l’assurance en Europe nous préoccupait : on sentait qu’il y avait le cumul d’une puissance marketing, de contact client, de traitement de la data, de connaissance des personnes… on a senti une menace et cela a beaucoup servi de déclic et a fait bouger l’entreprise. Puis, cela a été quelques années plus tard l’apparition des fintechs, des néo-assureurs qui ont pris des parts de marché. Mais pour beaucoup, ce sont des aventures qui n’ont pas été très pérennes, sur le break-even et sur l’implantation durable. Il y a beaucoup de cash qui a été brûlé. Mais là aussi, c’est une autre forme de menace qui pousse un dirigeant à entrer pleinement dans le sujet. Enfin, je pense qu’un autre « moment clé » a été le boom de la data. Nous avons créé il y a 10 ans un datalab pour pousser la nouvelle organisation de la donnée, de l’extraction jusqu’au stockage… Et à partir de là, nous avons commencé à nous ouvrir beaucoup plus. L’open source correspond bien à notre promesse mutualiste. En partageant nos propres lignes de code, cela intéresse une communauté de codeurs qui en réciprocité améliore nettement ce que nous pouvons produire.
De manière générale, ce qui m’a beaucoup aidé, c’est la réflexion qu’il a fallu mener sur la digitalisation des parcours client, quand on est attaché comme moi à la qualité de la relation avec les sociétaires. Nous traitons des millions d’appels par an qui génèrent de la fidélité et de la satisfaction : c’est une source de valeur pour nous. Nous avons donc dû nous demander très tôt si le digital n’allait pas enlever cette satisfaction et nous banaliser ? Nous ne pouvions pas attendre passivement face à ce risque.
La démocratisation rapide de l’IA depuis deux ans bouscule fortement les engagements pour un numérique plus sobre et responsable pris par de nombreuses organisations : comment gérez-vous les injonctions parfois contradictoires entre innovation rapide et numérique responsable ?
La réponse est loin d’être facile. C’est évidemment une question d’équilibre dans les choix technologiques et d’usages… mais de manière de faire aussi. Dans notre cas, nous essayons d’aborder les sujets d’innovation et notamment d’IA générative, à travers un principe de sobriété : ne pas faire des choses inutiles. Le monde de l’IA va très vite, mais la compréhension fine de nos besoins et des solutions qui y répondent n’est pas encore stabilisée pour que cela justifie des généralisations. Ma conviction, c’est qu’il faut investir uniquement quand on maîtrise les conséquences, environnementales ou sociales, que l’on va avoir. Par ailleurs, cette sobriété consiste aussi à faire en sorte que dans les LLM que nous utilisons, nous nous focalisions sur les données les plus pertinentes et les plus utiles. Cela ne sert à rien d’être trop large, trop gourmand. Nous voulons n’utiliser que l’essentiel pour apporter nos réponses. Mais surtout, il faut mesurer : l’impact de ce que nous déployons. C’est ce qui permet de piloter une trajectoire de transformation numérique qui ne percute pas notre « trajectoire CO2 » qui respecte les accords de Paris. En ce sens, nous avons mis en place un comité numérique éthique qui traite notamment de l’IA, sous l’angle des impacts négatifs qu’elle risque d’avoir et de la manière dont nous pouvons les corriger : impact environnemental, données personnelles, dépendances technologiques…
L’Europe peut-elle se différencier en la matière ?
Privilégier les acteurs européens, c’est effectivement une autre approche responsable. Dans le domaine des LLM, ce n’est pas évident, mais dans d’autres, comme l’hébergement, nous y parvenons plutôt bien. Je crois que paradoxalement, c’est l’une des rares conséquences positives du trumpisme : une accélération de la prise de conscience de l’importance de la souveraineté économique, et donc de la souveraineté numérique. Je suis frappé de l’évolution des discours en quelques semaines : le sujet se lie à la nécessité de garantir la transition écologique et à la nécessité de se saisir nous-mêmes de l’extraterritorialité de nos règles européennes. L’Union européenne s’est emparée du sujet et c’est heureux. La volonté d’investir dans un numérique souverain français ou européen s’affiche bien plus. C’est une conséquence heureuse de l’instabilité géopolitique actuelle. Au niveau de l’entreprise, la dépendance technologique est également un risque stratégique pensé en tant que tel. Nous voyons bien les limites et les risques que créent la généralisation du mode SaaS. Si les « robinets » se ferment du fait d’une décision politique, les conséquences sont lourdes pour un système d’information. Et sans surprise, cette dépendance est aussi corrélée à l’augmentation des tarifs par les acteurs qui sont en position de domination. Je constate qu’en interne, tout le monde s’est mis à réfléchir différemment sur le sujet.
Photo : © Chloé VOLLMER-LO / MAIF

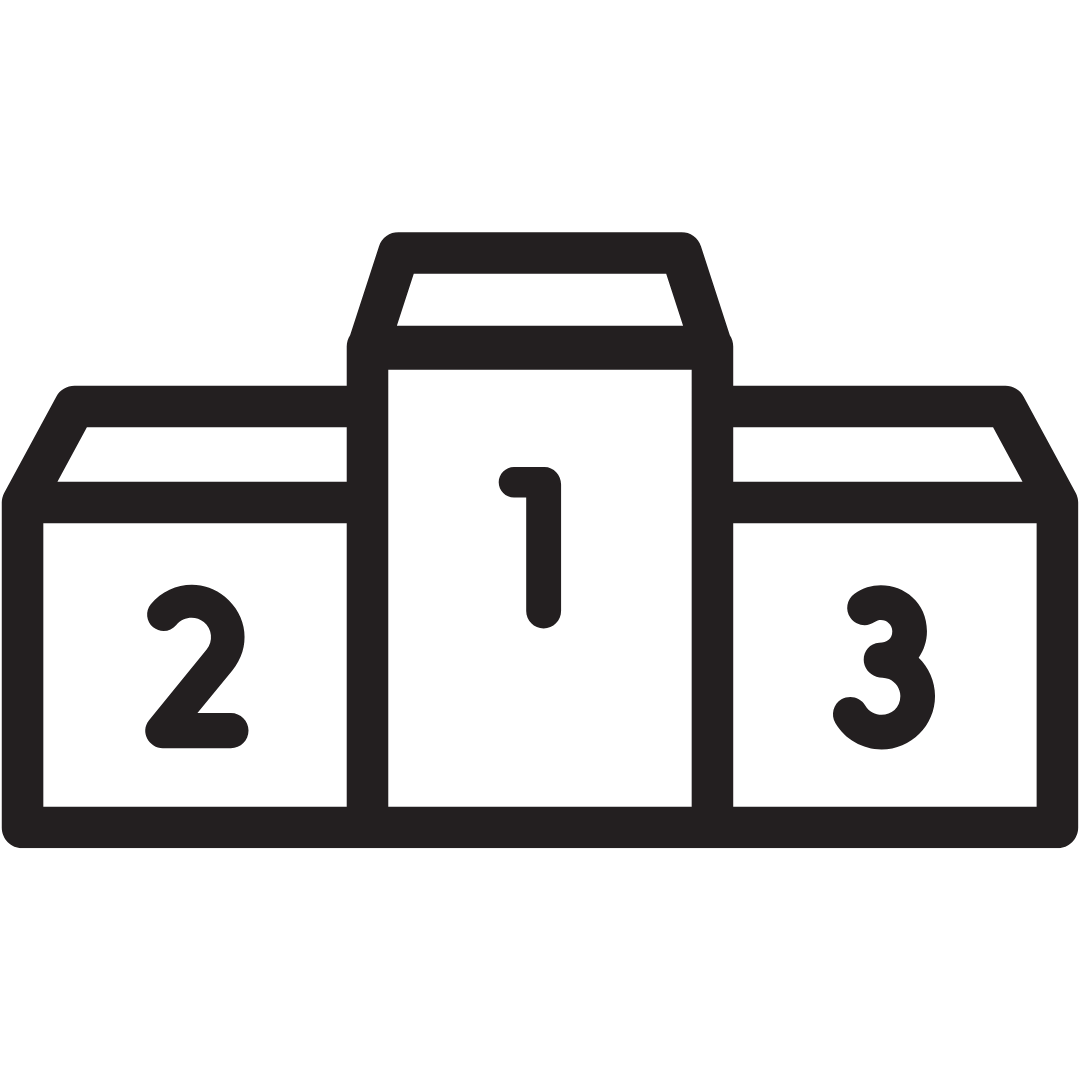 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique