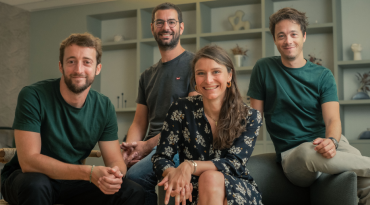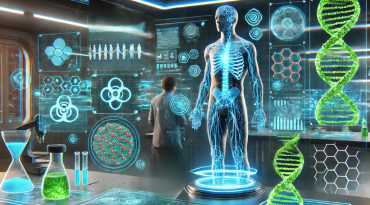Face au discours présentant le progrès technique comme une promesse de meilleure efficacité énergétique, l’économiste William Stanley Jevons avait déjà pressenti, à la charnière du XXe siècle, les externalités négatives que nos révolutions industrielles pouvaient induire. Victor Court, enseignant-chercheur en économie à l’IFP Energies nouvelles*, met à jour pour Alliancy ce concept à l’heure où le mythe de la dématérialisation numérique reproduit ce schéma d’invisibilisation du coût environnemental de nos usages.

Victor Court, enseignant-chercheur en économie à l’IFP Energies nouvelles.
Alliancy. Comment votre parcours vous a-t-il mené vers les questions énergétiques liées à notre économie ?
J’ai une formation initiale plutôt scientifique, puis j’ai suivi des études d’ingénieur. Je suis arrivé assez tardivement dans le champ économique. Lors de ma première année de master, j’ai été très surpris de constater que dans les modèles économiques standards l’énergie n’était pas incluse comme facteur de production pour expliquer la croissance économique. Ça a été une énorme surprise pour moi de constater que beaucoup d’économistes ne prenaient pas cet élément en compte pour rendre compte du moment charnière de la révolution industrielle. Ils évoquaient le changement technique, l’éducation des enfants, mais pas le charbon !
Par la suite, j’ai décidé d’entamer un doctorat d’économie, en orientant ma thèse sur le lien entre consommation d’énergie et croissance économique. Bien évidemment, je n’étais pas le premier à étudier cette question. Quelques économistes ont été prolifiques sur ce sujet depuis les années 1970 (par exemple Nicolas Georgescu-Roegen, Charles Hall ou Robert Ayres), mais ils sont restés assez minoritaires au sein de la discipline des sciences économiques.
Et par la suite, quelle a été la trajectoire de vos recherches ?
En 2018, j’ai fait mon post-doctorat à l’Université du Sussex à Brighton (Royaume-Uni), sur une problématique bien précise : sommes-nous certains que la dématérialisation de nos activités est avantageuse en termes de consommation énergétique ?
Concrètement, avec le télétravail par exemple, on se dit que puisque les salariés ne se déplacent plus sur site une partie de la semaine, les effets sont forcément bénéfiques pour l’environnement. Mais on a du mal à anticiper les « effets rebonds » induits par ces changements : duplication du matériel informatique nécessaire (au bureau et à la maison), chauffage et éclairage de la maison les jours de télétravail, trajet pour aller faire les courses depuis la maison plutôt que de les faire en rentrant du travail, etc.
Même chose au sujet du déploiement des antennes 5G : il est évident que par unité de donnée transmise elles consomment moins d’énergie que les antennes 4G, mais dans le même temps, elles permettent de nouveaux usages et donc plus de trafic. Par exemple, on peut désormais regarder des vidéos en 4K à des endroits où il n’était pas possible de le faire auparavant (métro, train, etc.).
Plus largement, depuis le siècle des Lumières, nous avons toujours tendance à considérer le changement technique comme un « progrès », en occultant ses effets négatifs. L’historien et sociologue Jacques Ellul résumait bien cette tendance : nous parvenons facilement à anticiper les effets positifs du changement technique – car ils sont immédiats et concrets – plutôt qu’à prévoir ses effets négatifs – plus diffus, abstraits et lointains dans le temps. C’est pour cette raison que je préfère toujours parler de « changement technique » plutôt que de « progrès technique ».
Depuis combien de temps connaît-on le principe de l’effet rebond ? En quoi consiste-t-il exactement ?
Avec son livre Sur la question du charbon publié en 1865, l’économiste William Stanley Jevons a été le premier à analyser les impacts contre-intuitifs de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Jevons avait compris que le fait de recourir à des machines à vapeur de plus en plus efficaces allait permettre d’utiliser de plus de machines et donc de consommer de plus en plus de charbon ! L’efficacité énergétique entraînait un accroissement de la consommation d’énergie au lieu d’une baisse parce que l’effet rebond venait annuler toutes les économies potentielles.
De nos jours, le même parallèle peut être fait avec la voiture thermique. On se dit logiquement que des moteurs plus performants permettent de baisser notre consommation d’essence. En réalité, si ma voiture est dotée d’un moteur plus efficace qu’avant, cela signifie que je suis mesure de parcourir la même distance qu’avant avec moins de carburant, et donc que je peux allouer une partie de mon revenu à un autre achat – comme un billet d’avion par exemple. C’est ce qu’on appelle un effet rebond « indirect ». Mais avec une voiture plus efficace, je peux aussi décider de parcourir plus de kilomètres avec la même quantité de carburant. Dans ce cas, on parle d’un effet rebond « direct ». Un autre effet rebond consiste à considérer que puisque le coût de la mobilité baisse grâce à l’efficacité énergétique, les constructeurs sont en mesure de proposer des voiture plus volumineuses et donc plus énergivores – à l’image des SUV ces dernières années. Dans le même temps, la baisse du coût de la mobilité peut inciter à développer les routes, les ponts, etc.
Tous ces effets rebonds ont joués à plein depuis l’arrivée des premières voitures il y a cent ans, et le résultat est clair : les économies d’énergie potentielles ont été plus que surcompensées, si bien que la consommation énergétique totale du secteur des transport a augmentée.
Beaucoup de personnes ne jurent aujourd’hui que par le changement technique pour résoudre nos défis écologiques. À quel moment pouvons-nous dater cette surenchère liée au « solutionnisme » technique ?
Comme je l’ai dit, croire que le changement technique est forcément un « progrès » ne date pas d’hier. Mais il me semble qu’en ce qui concerne l’efficacité énergétique, les chocs pétroliers des années 1970 ont été très importants dans l’imaginaire collectif. À cette époque, la prise de conscience – temporaire – de notre dépendance énergétique a pris une ampleur politique et nationale. Des moyens importants ont été débloqués pour augmenter l’efficacité énergétique de nos modes de production et de consommation, mais aussi pour électrifier une part croissante des usages et bien sûr faire croître le parc nucléaire dans le cas de la France.
Aujourd’hui, l’efficacité énergétique est même devenue un argument marketing, par exemple avec les labels (A, B, C…) que l’on peut voir sur les équipements électroménagers. Si l’on revient à la question du numérique, là aussi on cherche constamment à améliorer l’efficacité énergétique des appareils et des usages. Et, par exemple, il est évident que c’est une très bonne chose de savoir que Netflix a retravaillé le code de son algorithme pour que les requêtes faites à ses serveurs consomment moins d’énergie.
Mais ce type d’optimisation est nécessairement limité car un usage numérique donné requiert toujours un minimum de matière et d’énergie. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte les effets rebonds induits par ces changements techniques. Il est facile d’imaginer que le numérique va nous permettre de remplacer des choses matérielles et donc de consommer moins. Mais ce n’est évidemment pas exact. L’exemple des liseuses électroniques est évocateur : elles n’empêchent pas les utilisateurs de continuer d’acheter des livres papier. Ainsi, le nouvel usage de la lecture numérique vient s’additionner à l’ancienne pratique de la lecture papier plutôt que de la remplacer. On voit également les effets rebonds à l’œuvre dans la prolifération des objets connectés. Pour chaque innovation énergétique dans le numérique, il faudrait pouvoir anticiper les effets en termes d’usages et ainsi établir un bilan global de consommation énergétique. Mais dans la pratique cela est très compliqué, sinon impossible.
Dans son dernier livre sur « L’enfer numérique », le journaliste Guillaume Pitron qualifie le numérique d’ « inframonde » qui fonctionne à l’aide de « machinistes de l’exode numérique bravant les lois de la physique pour que des milliards aient l’illusion d’en être affranchis »…
Pour répondre à cette question, j’aimerais plutôt faire référence à Philippe Bihouix qui a publié les ouvrages L’Âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable, ainsi que Le bonheur était pour demain : les rêveries d’un ingénieur solitaire. Dans ce deuxième livre, Bihouix montre bien que le mythe d’une « dématérialisation » grâce au numérique est profondément ancré dans la culture occidentale.
La fausse croyance d’un PIB qui pourrait se dématérialiser date surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, à partir du moment où le tertiaire a explosé dans les pays les plus développés. Le tournant néolibéral des années 1980 a aussi accentué ce mythe, en favorisant la délocalisation massive de nos industries. Et finalement, le numérique est venu accentué cette impression trompeuse de déconnexion entre création de richesse et consommation d’énergie.
De nombreuses personnes pensent aujourd’hui que ce sont les « données » qui propulsent notre économie mondiale. Mais, dès que l’énergie ou les ressources matérielles se font plus rares, on voit bien que notre économie subit inévitablement un coup de frein. En particulier, si les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) sont peu visibles au quotidien,dès lors qu’elles se font plus rares, physiquement ou économiquement, cela crée mécaniquement des problèmes. La guerre en Ukraine illustre bien ce phénomène en ce moment.
Quels usages numériques devraient être limités en priorité ?
C’est assez compliqué de répondre à cette question car cela relève d’un débat normatif. Nous vivons dans un monde régi principalement par l’idée qu’en matière de choix de consommation il faut laisser le marché décider quels usages devraient être limités ou non via le système des prix. Le problème est que les prix de marchés prennent très mal en compte les coûts environnementaux des usages. Dans un monde idéal, il faudrait pouvoir mesurer toutes les externalités négatives induites par un bien donné et les intégrer dans son prix. En pratique, une telle approche est impossible à mettre en œuvre.
Des actions individuelles peuvent être menées pour limiter la surconsommation de streaming vidéo ou encore l’envoi d’email avec pièces jointes. Nous pouvons également éviter de systématiquement passer par la visio pour passer nos appels, ou baisser la qualité des vidéos que nous regardons sur internet. Mais comme le Shift Project l’a montré dans plusieurs rapports, il est vrai qu’au-delà des actions individuelles tout est encore à faire pour maîtriser les impacts du numérique à l’échelle collective.
*successeur de l’Institut français du pétrole

 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique