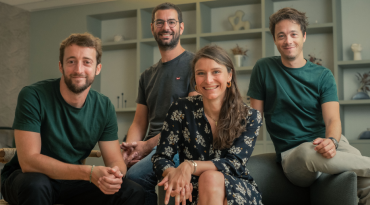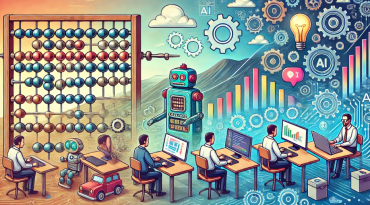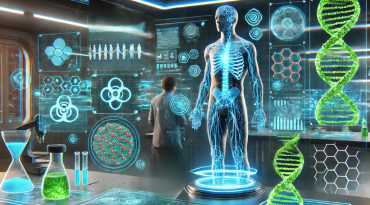Les dépendances technologiques européennes ne sont plus à prouver. Mais si elles étaient un compromis acceptable pour certains du fait de la proximité naturelle avec l’allié américain, le réalignement mené par l’administration Trump remet en cause les parti-pris atlantistes de la tech.
« Nous assistons à la fin d’un cycle de recherche d’universalisme et d’interopérabilité dans l’espace numérique mondial qui se fragmente au rythme des rivalités économiques, technologiques et de gouvernance. » En une phrase, le dernier rapport du Cigref résume bien le changement profond de paradigme qui s’articule autour de la transformation numérique des organisations. Le réseau des grandes entreprises françaises donne un coup de projecteur salutaire sur le croisement entre géopolitique et stratégies numériques dans cette synthèse d’une trentaine de pages, particulièrement accessible. Il appelle notamment les directions du numérique à travailler leur « autonomie stratégique » en prenant en compte de nouveaux critères que ceux, comme les coûts, la disponibilité ou la nécessité d’une approche par plaques géographiques « follow the sun », qui ont prévalu jusqu’alors.
Le document reconnaît à raison que certaines grandes entreprises se penchent déjà sur ces questions depuis quelques années, tout en pointant le fait qu’un nombre important préfèrent encore faire l’autruche et ne pas y réfléchir. Pourtant, au-delà des effets directs des crises et des conflits (en Ukraine et au Moyen-Orient notamment) sur les chaînes d’approvisionnement, bien documentés, c’est le cas des États-Unis qui mérite aujourd’hui de retenir toute l’attention des dirigeants. Il suffit de prendre la mesure de la cascade d’actualités et d’annonces venant d’outre-Atlantique depuis un mois, pour comprendre que cet aspect de la géopolitique va très fortement peser sur les stratégies numériques en 2025.
Un réalignement américain glaçant
En ce sens, la seule faiblesse du rapport du Cigref est d’avoir été rédigé juste avant que Donald Trump lance ses premières actions décisives. Ainsi, la synthèse n’intègre pas ce premier mois hautement perturbant du « règne » d’un président américain qui laisse aujourd’hui clairement voir que ses tentations autocratiques ne sont pas juste de l’esbroufe de campagne électorale. Outre la brutalité de ses rafales « d’executive orders » sur la politique publique intérieure de la première puissance mondiale, c’est bien le changement profond d’alignement que « l’allié » américain est en train d’opérer au niveau international qui doit inquiéter.
Peut-on d’ailleurs encore seulement parler d’allié ? Les habitudes ont la vie dure et l’apparat politique comme la visite du président Emmanuel Macron à la Maison Blanche fin février, peut contribuer à sauver les apparences… Mais un cap a bel et bien été franchi quand le président Trump et son administration ont commencé à reprendre les éléments de langage de l’agresseur russe concernant la guerre en Ukraine. En parallèle, il réécrit aussi l’histoire du Vieux Continent en déclarant que l’Union européenne a été créée avant tout pour nuire aux États-Unis… un moyen de justifier sa volonté d’appliquer des droits de douane aux produits européens.
La fin des valeurs partagées ?
Par le passé, on avait le droit de ne pas être très à l’aise avec les comportements et la raison d’État d’un allié américain qui n’hésitait pas à profiter de son statut pour dominer les relations avec des tiers. Mais les postures atlantistes en Europe étaient malgré tout entendables, car les dénominateurs communs paraissaient immuables, notamment le partage des valeurs démocratiques et libérales. Dorénavant, être atlantiste revient donc à accepter de s’aligner sur un « allié » qui vous voit comme un adversaire… et préfère soutenir un ennemi plutôt que de s’opposer à ses exactions.
Avec quel impact pour notre univers de la tech ? Le rapport du Cigref résume simplement les forces en présence : « L’Union européenne fait face à une dépendance structurelle envers les grandes entreprises technologiques américaines, qui capturent une part croissante de la valeur numérique créée en Europe. Cette situation met en lumière les tensions autour de la souveraineté numérique de l’Europe, qui se trouve fragilisée par une concentration de pouvoir entre les mains de quelques acteurs étrangers, menaçant à long terme la compétitivité et l’autonomie stratégique de ses entreprises. »
Alternatives et fragmentations
Dans ce contexte, la coopération avec les entreprises américaines ne va pas manquer de poser de plus en plus question. En effet, tout « produit édité est toujours associé à son pays d’origine » souligne le rapport. Or, l’instabilité politique internationale va rendre toujours plus difficile dans les prochains mois de se contenter du « business as usual ». Les avantages, en termes d’innovation, de capacités, de facilités d’usage, des collaborations avec les leaders de la tech américaine risquent d’être réinterrogés à l’aune du comportement incendiaire de leurs autorités publiques.
Pour le Cigref, l’Open Source ou l’Inner Source (le développement par les entreprises elles-mêmes) échappent à cette notion d’appartenance nationale et peuvent donc tirer leur épingle du jeu face à ces tensions géostratégiques. Mais au-delà, ces alternatives ne répondent pas à la fragmentation grandissante que vont connaître les systèmes numériques, la géopolitique alimentant profondément une défiance aiguë entre les partenaires d’hier, « au risque de compromettre les coopérations et les interopérabilités internationales ». C’est peu de le dire…

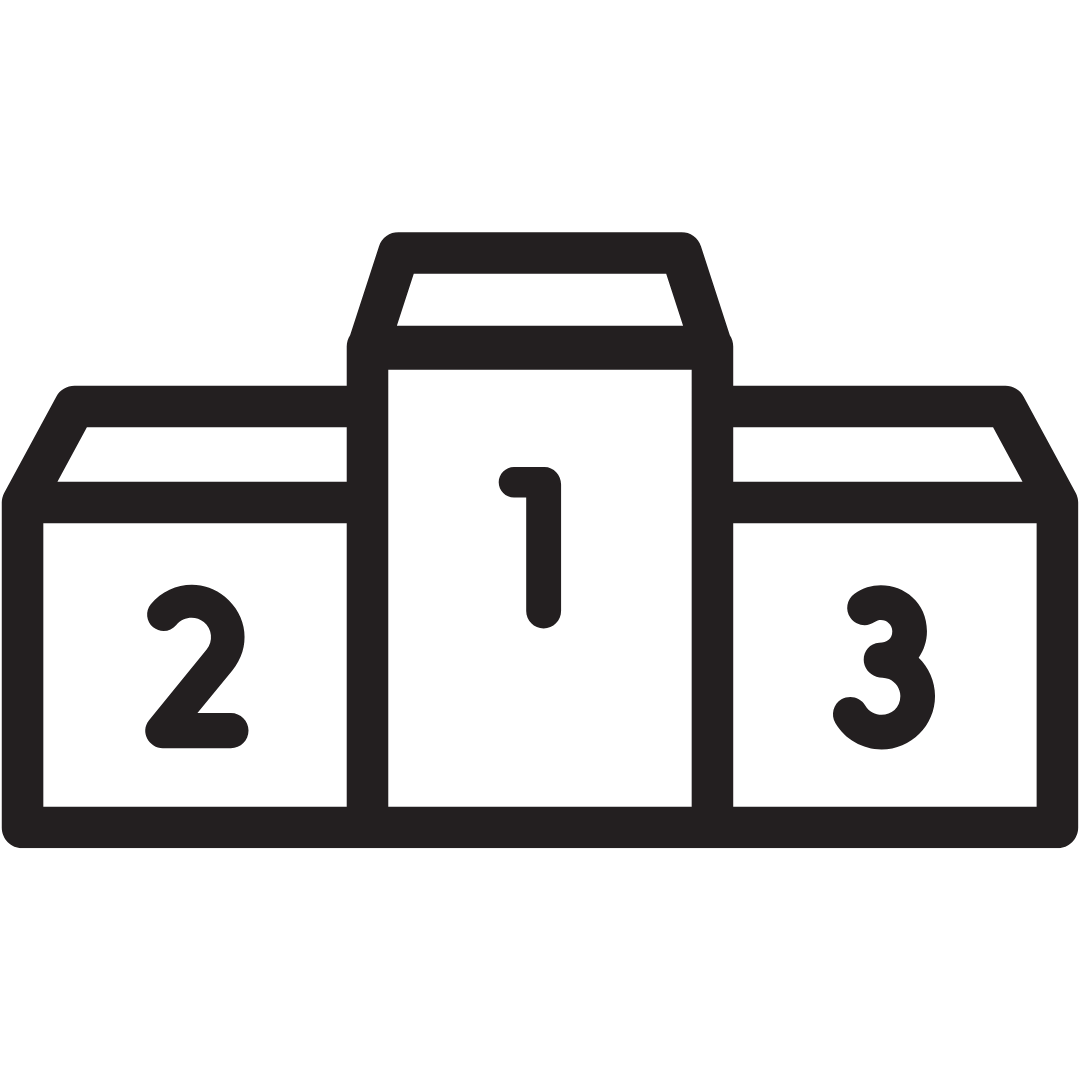 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique