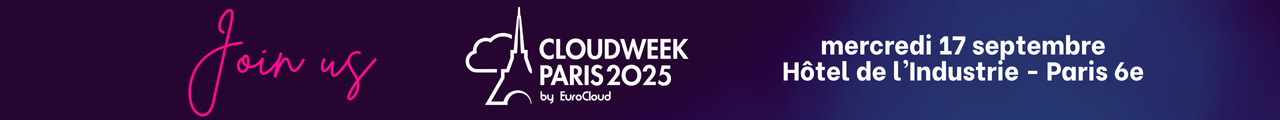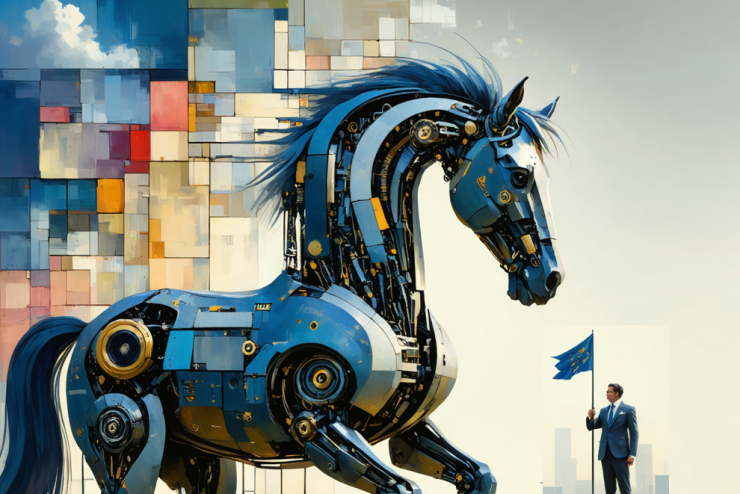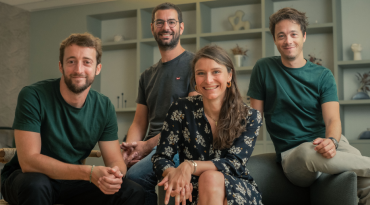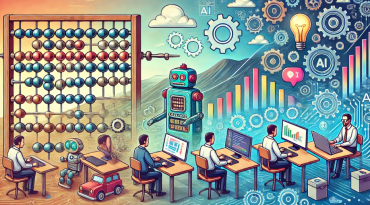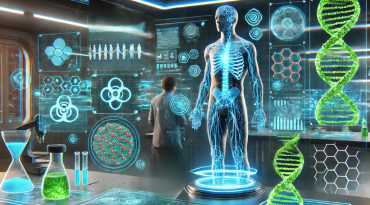Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid sur le commerce mondial : après avoir annoncé (de nouveau) la mise en place rapide de droits de douane de 50 % pour l’Union européenne, le 23 mai, il a fait machine arrière trois jours plus tard, accordant (de nouveau) un délai de plusieurs semaines pour les négociations. L’incertitude fait évidemment jouer les bourses au yoyo et crée de l’attentisme chez les investisseurs et les entreprises. Mais sur le plus long terme, le sujet est-il vraiment là pour l’Europe ? « Les barrières qui existent entre les pays européens ont beaucoup plus d’impact que ce que nous infligent les États-Unis », a répondu l’économiste Philippe Aghion, en clôture de la conférence « Comment relancer la productivité en France et en Europe » organisée par le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, lundi 26 mai. Pour les spécialistes réunis, le long décrochage de productivité est un sujet majeur, mal compris par beaucoup de dirigeants et non perçu par la population… Avec une question à la clé : à quelles conditions le « cheval fougueux de l’intelligence artificielle » que décrit Philippe Aghion peut-il changer la donne pour l’Europe ?
Délicate étude de la productivité
Contrairement à certains de ses partenaires européens comme l’Italie, la France n’a pas retrouvé ses niveaux de productivité d’avant la crise pandémique, et la tendance s’est même dégradée depuis. Le phénomène est documenté : dans l’Hexagone, l’accent mis sur l’apprentissage a mécaniquement amoindri la productivité moyenne et la rétention de l’emploi avec les politiques post-Covid a également eu des effets négatifs. Deux secteurs sont particulièrement touchés : le commerce de détail et la construction. Mais derrière le terme de productivité se cachent des réalités et des calculs complexes, comme l’a rappelé le magazine Alternatives Économiques dans un long dossier. Et c’est dans ce contexte que la démocratisation de l’IA intervient. Le réflexe primaire serait alors de se dire que son adoption grandissante va agir fondamentalement sur la productivité des acteurs économiques. Mais l’équation n’est pas aussi simple.
Adoption tardive des technologies
L’un des freins structurels du continent vient justement de « la relative lenteur à adopter les pratiques et technologies qui génèrent de la productivité », rappelle Antonin Bergeaud, lauréat 2025 du prix du meilleur jeune économiste, qui épingle aussi les dépenses de R&D très basses en Europe par rapport à la Chine et aux USA. Si les dépenses publiques en la matière sont à peu près comparables, l’investissement réalisé par les entreprises est notablement plus bas, avec un différentiel évalué à 100 à 150 milliards de dollars par an entre l’Europe et les États-Unis. Avec pour résultat une adoption imparfaite de la technologie et de ses avantages. « On adopte la technologie qui vient des États-Unis avec du retard et en plus elle n’est pas parfaitement adaptée à nos modèles et nos réglementations », estime l’économiste, pour qui cela multiplie encore plus les frictions dans la recherche de gains de productivité. Autrement dit, même si les économistes, et notamment les auteurs du dernier rapport du Conseil national de la productivité, ont une vision plus précise des gains apportés par l’IA en tant que telle (« Nous regardons les effets sur les tâches, plutôt que seulement sur l’emploi, afin d’avoir une compréhension plus fine », a rappelé Anne Bouverot, la co-présidente de la Commission sur l’IA), le cœur du problème vient des moteurs de croissance sur lesquels s’appuie l’Europe depuis des années.
Le piège de la croissance par imitation plutôt que par innovation
 « L’Europe a beaucoup parié sur l’imitation technologique pour sa croissance : mais ce n’est pas de l’innovation de rupture, ce n’est pas une croissance par l’innovation. Et nous n’avons pas les institutions et les politiques pour favoriser ces ruptures », met en avant Philippe Aghion. Face à cette situation, le levier technologique ne peut qu’être secondaire par rapport au fait de modifier le substrat des grandes réalités économiques européennes. Dans la lignée du rapport Draghi, l’économiste met donc en lumière trois priorités en la matière : marché unique, écosystème financier et financement intelligent de la recherche. « Nous n’avons pas de réel marché unique pour les biens et services, ce qui ne permet pas d’accroître la demande et l’intérêt de l’innovation. Et cet objectif est en plus entravé par la surtransposition des normes européennes dans les droits nationaux, ce qui crée des réglementations fragmentées supplémentaires », assène Philippe Aghion. Nos faiblesses en capital-risque et en fonds de pension ne sont par ailleurs pas compensées par une bonne capacité de mobilisation de l’épargne des ménages vers l’innovation, contrairement aux États-Unis. Enfin, malgré des capacités de recherche de premier plan, le fléchage de dotations publiques et privées pour des financements de long terme reste minimaliste. « Des fondations américaines financent des chercheurs pour 10 ans, c’est cela qui crée des Prix Nobel. Et en parallèle, le modèle des agences comme la DARPA fait le lien entre recherche fondamentale et mission précise à réaliser, tout en animant la concurrence entre les entreprises qui veulent répondre aux projets. En Europe, notre seul équivalent est l’European Innovation Council, mais il finance surtout les étapes de commercialisation, pas de recherche fondamentale », décrit également l’économiste.
« L’Europe a beaucoup parié sur l’imitation technologique pour sa croissance : mais ce n’est pas de l’innovation de rupture, ce n’est pas une croissance par l’innovation. Et nous n’avons pas les institutions et les politiques pour favoriser ces ruptures », met en avant Philippe Aghion. Face à cette situation, le levier technologique ne peut qu’être secondaire par rapport au fait de modifier le substrat des grandes réalités économiques européennes. Dans la lignée du rapport Draghi, l’économiste met donc en lumière trois priorités en la matière : marché unique, écosystème financier et financement intelligent de la recherche. « Nous n’avons pas de réel marché unique pour les biens et services, ce qui ne permet pas d’accroître la demande et l’intérêt de l’innovation. Et cet objectif est en plus entravé par la surtransposition des normes européennes dans les droits nationaux, ce qui crée des réglementations fragmentées supplémentaires », assène Philippe Aghion. Nos faiblesses en capital-risque et en fonds de pension ne sont par ailleurs pas compensées par une bonne capacité de mobilisation de l’épargne des ménages vers l’innovation, contrairement aux États-Unis. Enfin, malgré des capacités de recherche de premier plan, le fléchage de dotations publiques et privées pour des financements de long terme reste minimaliste. « Des fondations américaines financent des chercheurs pour 10 ans, c’est cela qui crée des Prix Nobel. Et en parallèle, le modèle des agences comme la DARPA fait le lien entre recherche fondamentale et mission précise à réaliser, tout en animant la concurrence entre les entreprises qui veulent répondre aux projets. En Europe, notre seul équivalent est l’European Innovation Council, mais il finance surtout les étapes de commercialisation, pas de recherche fondamentale », décrit également l’économiste.
Enfin une perception de l’urgence ?
La conclusion de la conférence consacrée à la productivité s’est donc détachée de ce seul thème, pour englober une problématique plus globale. « L’IA est un cheval fougueux, qui peut vous amener dans le mur ou vous faire gagner beaucoup de temps si vous savez le guider », rappelle Philippe Aghion. Pour maximiser les chances d’obtenir des résultats à la hauteur des attentes, la partie se joue donc sur les sujets fondamentaux que sont les systèmes éducatifs, sociaux (« il nous faudrait un système de flexi-sécurité à la danoise ») et financiers avant tout. Serons-nous capables de mettre en œuvre les politiques et de changer les institutions qui permettront cette réinvention ? « Uniquement si le déclin technologique de l’Europe est enfin perçu comme une urgence, à la manière du Covid ou de l’invasion de l’Ukraine. Peut-être que le retour de Trump sera le catalyseur dont nous avons besoin ». De quoi appeler à ne pas se laisser prendre au piège de l’épouvantail des « négociations » sur les droits de douane voulu par le président américain. D’autres combats demandent l’énergie des décideurs européens.

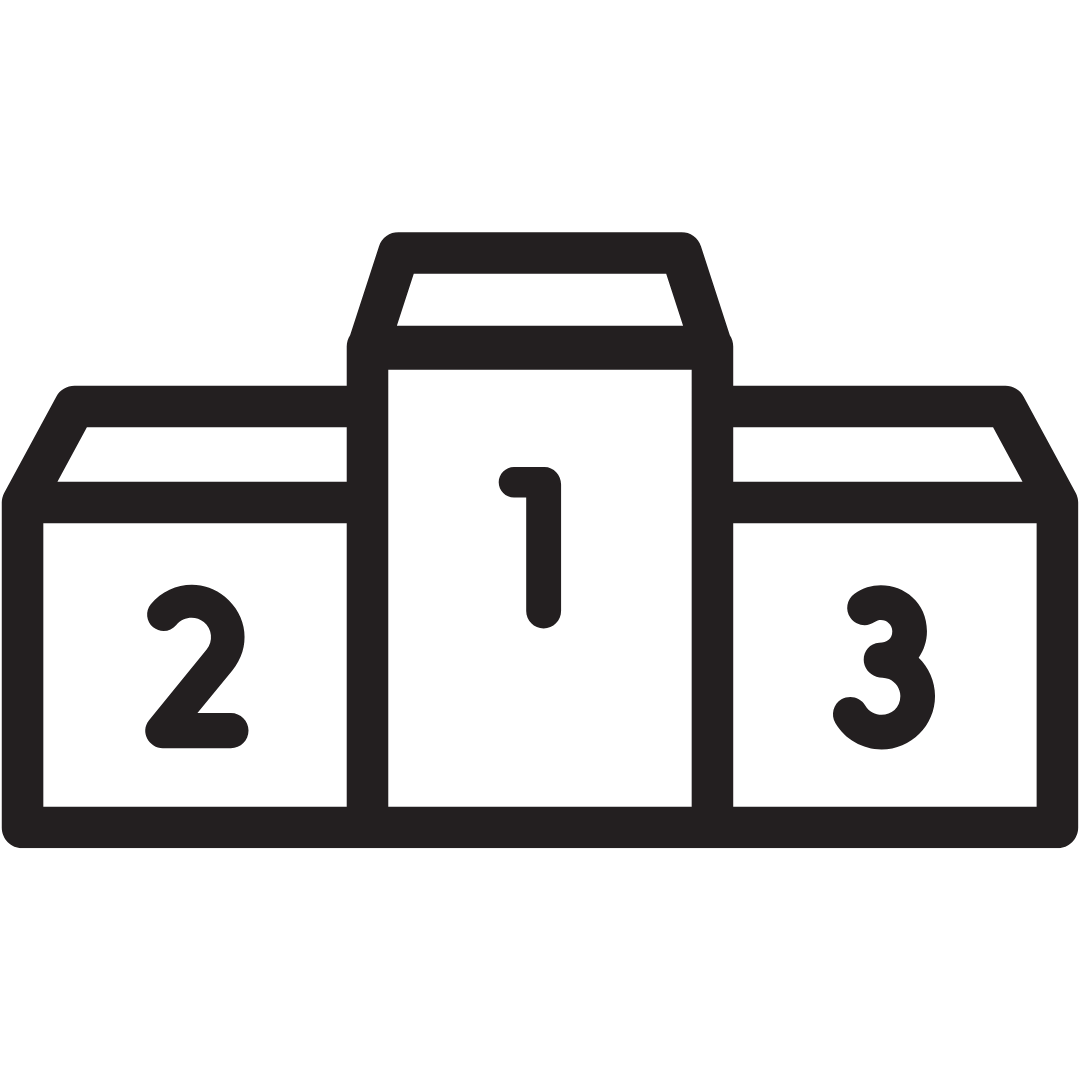 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders Alliancy Elevate
Alliancy Elevate International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique