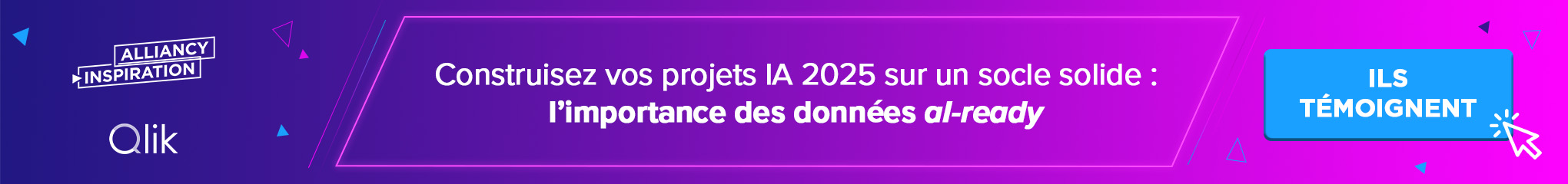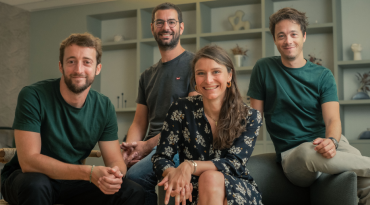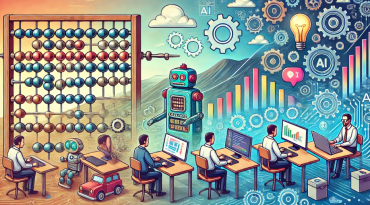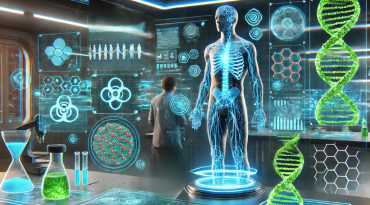Le Sommet pour l’action de l’IA s’est tenu à Paris les 10 et 11 février, mettant l’accent sur les usages concrets et le potentiel de l’intelligence artificielle. Loin des craintes et des débats réglementaires, les discussions ont porté sur une IA au service du bien commun.
Arracher l’intelligence artificielle (IA) à l’imaginaire de science-fiction, la faire s’assoir aux bancs de la science et, plus encore, l’admettre dans la boîte à outils des entreprises, c’est en ce sens que le Sommet pour l’action de l’IA a réuni environ 1500 personnes et plus d’une centaine de pays les 10 et 11 février, au Grand Palais à Paris. “L’IA révèle un potentiel sans précédent, mais la peur à son égard est démesurée”, a déclaré Anne Bouverot, présidente du conseil d’administration de l’ENS, au discours d’ouverture de l’évènement. L’homme a déjà relevé ce défi aux allures sciences-fictives, lancé par Alan Turing en 1950 : la création d’une machine pensante. Depuis 2012, les scientifiques ont réuni les trois piliers fondateurs de l’IA, à savoir, les algorithmes, la big data et la puissance de calcul. “Alan Turing avait eu un aperçu de l’avenir. Maintenant que nous avons relevé ce défi, il est temps de s’en lancer un autre : créer une IA qui soit une force pour le bien commun”, a projeté la docteure Fei-Fei, informaticienne et chercheuse américaine spécialiste de la vision artificielle, lors du discours d’ouverture du sommet. Alors, contrairement aux précédents sommets de Bletchley Park et de Séoul, l’édition parisienne a mis l’accent sur les cas pratiques et l’innovation, plutôt que les réglementations et l’appréhension. “La vraie puissance de l’IA ne réside pas dans la pensée, mais dans l’action à travers la pensée”, a suggéré le docteur Fei-Fei. L’informaticienne considère ainsi l’intelligence artificielle agentique comme la dernière étape pour l’utilisation en entreprise.
Un tournant civilisationnel
En revanche, une technologie dotée de l’intelligence spatiale, soit la capacité à voir, imaginer, visualiser et différencier des objets en deux ou trois dimensions, recèle encore bien d’autres compétences. La question : dans quel but va-t-on utiliser la puissance de l’intelligence artificielle ? “L’intelligence spatiale est à l’origine de nos civilisations et nous sommes à un tournant civilisationnel. On doit recentrer l’IA sur l’homme à travers trois objectifs : la dignité, l’agentivité et la communauté”, a ajouté l’informaticienne américaine. Pour elle, ces trois fondations permettront d’établir une technologie éthique, donc durable et inclusive. La dignité de l’homme se reconnaît dans sa disposition à prendre des décisions et à effectuer des actions par soi-même. Un projet de Standford tente donc de répondre à cette exigence par l’invention d’un bras robotique. Ce-dernier agit en fonction des pensées et établit une connexion non-invasive, permettant de retrouver une mobilité. Le deuxième point souligne la transformation obligatoire du monde du travail, comme à chaque transformation technologique, sans pour autant remplacer l’humain. L’agentivité permettrait la diminution de la charge des travailleurs, au profit de tâches à plus grandes valeurs ajoutées et d’une hausse des capacités humaines. Quant à la communauté, la technologie semble davantage divisée par la création des bulles informationnelles, amplifiant les discours de haine. « Mais, l’IA peut aussi créer une communauté plus forte grâce aux outils d’inclusions, comme l’aide à la navigation pour les personnes atteintes de dyslexie”, a répliqué le docteur Fei-Fei. Cette approche est partagée par les acteurs internationaux avec 58 pays signataires de l’accord pour une intelligence artificielle « ouverte », « inclusive » et « éthique ». Seulement, les États-Unis et le Royaume unis refusent de signer, arguant le profit national au détriment du bien commun.

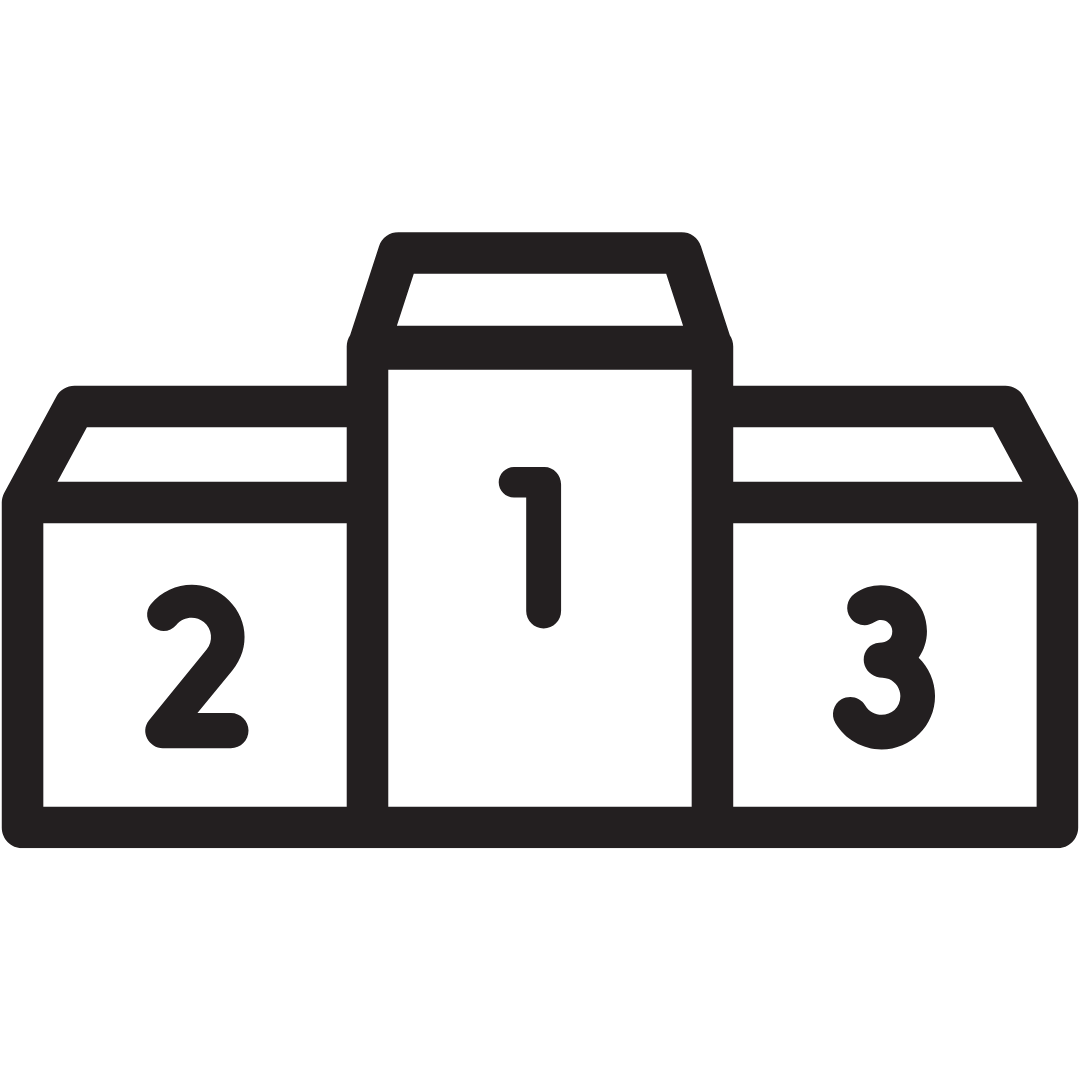 Tech In Sport
Tech In Sport Green Tech Leaders
Green Tech Leaders International
International Nominations
Nominations Politique publique
Politique publique